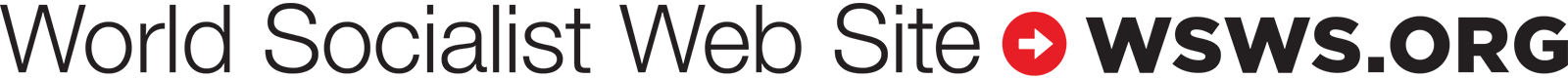Cette conférence fut donnée par Nick Beams, secrétaire national du Parti de l'égalité socialiste (Australie) et membre du comité éditorial du WSWS, lors de l'école d'été du Parti de l'égalité socialiste (USA) qui s'est tenue du 14 août au 20 août 2005 à Ann Arbor, Michigan.
La Guerre et l'Internationale de Trotsky
Dans son livre La Guerre et l'Internationale, d'abord publié sous forme périodique dans le journal Golos en novembre 1914, Léon Trotsky fournit une analyse tout à fait remarquable et pénétrante de la guerre qui avait éclatée juste trois mois auparavant. Comme tous les autres dirigeants marxistes de cette époque dont, parmi les figures principales, Lénine et Rosa Luxembourg, Trotsky était préoccupé par deux questions liées entre elles: 1) les origines de la guerre et la relation de celle-ci au développement historique du capitalisme et 2) l’élaboration d'une stratégie pour la classe ouvrière confrontée à la trahison des dirigeants de la Deuxième Internationale — par-dessus tout celle des dirigeants de la social-démocratie allemande — qui avaient reniés les décisions de leurs propres congrès et fournis un soutien à leur « propres » classes dirigeantes sur les bases de la défense nationale.
Pour Trotsky, la tâche théorique la plus pressante, dont dépendaient toutes les considérations stratégiques et tactiques, était de situer l'éruption de la guerre dans le développement historique de l'économie capitaliste mondiale.
Marx avait expliqué que l'ère de la révolution sociale survient lorsque « les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. » A ce point, ces relations sont transformées de formes du développement des forces productives en entraves de celles-ci.
C'est en cela que réside la signification de la guerre. Elle annonçait le fait que la totalité du système de l'Etat nation, qui avait été responsable de la croissance économique sans précédent des quatre décennies précédentes — un véritable trampoline pour le bond des forces productives, ainsi que Trotsky l'avait une fois appelé — était devenu une entrave à la poursuite de leur développement rationnel. L'humanité était entrée dans l'âge de la révolution sociale.
« Les forces productives que le capitalisme a fait se développer ont dépassé les limites de la nation et de l'Etat », écrivit Trotsky dans la toute première phrase de son analyse. « L'Etat national, la forme politique actuelle, est trop étroite pour l'exploitation de ces forces productives. La tendance naturelle de notre système économique, est par conséquent de chercher à percer les limites de l'Etat. La totalité du globe, la terre et la mer, la surface tout comme l'intérieur sont devenus un seul atelier économique, dont les différentes parties sont inséparablement liées entre elles. » [1]
Pour Trotsky, ce processus, maintenant appelé mondialisation, avait une grande signification. Si l'avancée de l'humanité peut être ramené à une seule mesure, alors il s'agit sûrement de la productivité du travail, dont la croissance fournit la base matérielle pour l'avancement de la civilisation humaine. Et une productivité accrue du travail est inséparablement liée à une expansion des forces productives sur une base locale, régionale et mondiale. Le développement des forces productives sur une échelle mondiale avait progressé à un rythme rapide dans les dernières décennies du dix-neuvième siècle sous l'égide des puissances capitalistes en expansion.
Mais le processus était de plus en plus contradictoire, car, comme l'expliquait Trotsky « les Etats capitalistes en vinrent à s’affronter pour le contrôle d’un système économique s’étendant au monde entier, pour le profit de la bourgeoisie de chaque pays. Ce que la politique de l’impérialisme a démontré plus que toute autre chose, c’est que le vieil Etat national qui avait été créé lors des guerres de 1789-1815, 1848-1859, 1864-66, et 1870 a survécu à lui-même et constitue maintenant un insupportable obstacle au développement économique. La guerre actuelle est dans son fondement une révolte des forces productives contre la forme politique de la nation et de l’Etat. Elle signifie l’effondrement de l’Etat national en tant qu’unité économique indépendante. » [2]
La tâche à laquelle était confrontée l'humanité était d'assurer le développement harmonieux des forces productives qui avaient complètement débordé le cadre de l'Etat-nation. Toutefois, les divers gouvernements bourgeois proposaient de résoudre ce problème « non grâce à la coopération organisée et intelligente de tous les producteurs de l’humanité, mais par l’exploitation du système économique mondial par la classe capitaliste du pays victorieux, pays qui sera transformé par cette guerre d’un pays puissant en puissance mondiale. » [3]
La guerre, insistait Trotsky, signifiait non seulement la ruine de l'Etat national, comme unité économique indépendante, mais la fin du rôle historiquement progressiste de l'économie capitaliste. Le système de la propriété privée et la lutte consécutive pour les marchés et les profits menaçait le futur même de la civilisation.
« Le développement futur de l’économie mondiale sur une base capitaliste signifie une lutte sans fin pour des terrains d’exploitation nouveaux et sans cesse renouvelés qui doivent être obtenus d’une seule et même source, la terre. La rivalité économique sous la bannière du militarisme s’accompagne de prédation et de destruction qui violent les principes élémentaires de l’économie humaine. La production mondiale se révolte non seulement contre la confusion produite par les divisions nationales et étatiques, mais aussi contre l’organisation économique capitaliste, qui est devenue une désorganisation barbare et chaotique. La guerre de 1914 est l’effondrement le plus colossal dans l’histoire d’un système économique détruit par ses propres contradictions internes. » [4]
L'utilisation du terme « effondrement » n'était pas accidentelle. Elle constituait une référence directe aux révisions de Bernstein, qui avait cherché à retirer le cœur révolutionnaire du programme marxiste avec son insistance que « la théorie de l'effondrement » de Marx avait été réfutée par les évènements. Maintenant l'histoire avait rendu son verdict sur la controverse révisionniste. Les tendances économiques dont Bernstein soutenait qu'elles atténuaient et surmontaient les contradictions du mode de production capitaliste, avaient en fait porté celles-ci à de nouveaux et terrifiants apogées.
Cette analyse de la signification historique objective de la guerre avait des implications immédiates pour le développement d'une perspective pour la classe ouvrière. Il fallait une rupture complète avec les politiques nationalistes et gradualistes de la Seconde Internationale. Contre ceux qui maintenaient que la première tâche de la classe ouvrière était la défense nationale, après laquelle la lutte pour le socialisme pourrait reprendre, Trotsky expliquait que « Pour le prolétariat européen, il ne s'agit pas de défendre la "Patrie" nationaliste qui est le principal frein au progrès économique ».
Le thème central parcourant toute l’analyse de Trotsky était son insistance que le développement de l’impérialisme et l’éruption de la guerre signifiaient la naissance d’une nouvelle époque dans le développement de la civilisation humaine.
« L’impérialisme » écrivait-il, « représente l’expression prédatrice d’une tendance progressiste du développement économique — la construction d’une économie humaine à l’échelle mondiale, libérée des entraves de la nation et de l’Etat. L’idée nationale, sous sa forme nue, quand on l’oppose à l’impérialisme, n’est pas seulement impotente mais aussi réactionnaire : elle fait refluer la vie économique de l’humanité dans les vêtements étriqués de la limitation nationale. » [5]
Le développement de l’impérialisme et l’éruption de la guerre étaient l’expression contradictoire du fait qu’une nouvelle forme d’organisation sociale était en gestation, luttant pour naître. En conséquence, il ne pouvait y avoir de retour au statu quo ante bellum [signifiant « comme les choses étaient avant la guerre », ndt], parce que cette époque avait vécue.
La seule façon de répondre à la « confusion impérialiste » du capitalisme consistait à « opposer à celui-ci, comme le programme pratique du jour, l’organisation socialiste de l’économie mondiale. La guerre est la méthode par laquelle le capitalisme, au point culminant de son développement, cherche à résoudre des contradictions insolubles. A cette méthode, le prolétariat doit opposer sa propre méthode, la méthode de la révolution socialiste. » [6]
On peut dire, sans avoir peur d’exagérer, que dès le tout début de la guerre toutes les ressources idéologiques et politiques des classes dirigeantes capitalistes se concentrèrent sur un point essentiel : réfuter l’analyse marxiste selon laquelle l’éruption de la Première Guerre mondiale signifiait la banqueroute historique du système capitaliste et la nécessité de son remplacement par le socialisme international de façon à mener plus avant le développement rationnel des forces productives de l’humanité.
Dans l’ardeur du conflit, les politiciens bourgeois de tous les camps cherchèrent à en faire porter la responsabilité à leurs adversaires : pour les politiciens anglais, la guerre était le résultat de l’agression allemande, qui conduisit à la violation de la neutralité belge ; pour la classe dirigeante allemande, le problème était la barbarie russe et la tentative des autres puissances de refuser à l’Allemagne sa place légitime dans l’ordre économique mondial ; pour la bourgeoisie française, la guerre était menée contre l’oppression allemande, malgré l’alliance avec l’autocratie tsariste. A la fin de la guerre, les vainqueurs tentèrent de s’absoudre eux-mêmes de la responsabilité de la conflagration en écrivant dans le Traité de Versailles la clause de la « responsabilité de la guerre » faisant porter la faute à l’Allemagne.
Pour l’historien américain devenu président, Woodrow Wilson, c’étaient les méthodes politiques du dix-neuvième siècle qui étaient responsables de la guerre, fondées sur ce qu’on appelait l’équilibre du pouvoir, la diplomatie secrète et les alliances. L’analyse de Wilson était motivée, au moins en partie, par sa compréhension que si le capitalisme résistait au choc de la guerre, il faudrait promouvoir une nouvelle perspective faisant appel à la démocratie et à la liberté. De façon significative, alors qu’il préparait les fameux Quatorze Points sur lesquels il allait fonder les efforts américains pour réorganiser l’ordre d’après-guerre et pour donner au monde la sécurité nécessaire à la démocratie, Wilson étudia le livret de Trotsky La Guerre et l'Internationale.
Après la fin de la guerre, le premier ministre pendant la guerre, Lloyd George, tenta d’absoudre tous les politiciens bourgeois du blâme de la conflagration. Elle était survenue presque par inadvertance, une sorte de confusion. Personne « à la tête des affaires ne voulait vraiment la guerre » en juin 1914, expliqua-t-il. Ce fut quelque chose où « ils glissèrent ou plutôt chancelèrent et trébuchèrent. » Il devait répéter cet argument dans ses mémoires de la guerre. « Les nations glissèrent par-dessus le bord et tombèrent dans le chaudron bouillonnant de la guerre sans aucune trace d’appréhension ou de désarroi. » Personne ne voulait la guerre. [7]
Plus de neuf décennies plus tard, la question des origines de la Première Guerre mondiale a toujours une grande importance et une grande signification. La raison n’est pas difficile à trouver. Elle tient dans le fait, comme le formule l’historien américain et analyste de politique étrangère, George F. Kennan, que la guerre fut « la grande catastrophe séminale de ce siècle ». Les massacres routiniers dans les tranchées, dans lesquels vague après vague de jeunes gens — certains à peine plus que des enfants — étaient envoyés à maintes reprises « monter à l’assaut », inaugura une nouvelle époque de barbarie et entraîna la mort de millions de personnes.
Quelles sont les origines de cette catastrophe ? Sont-elles enracinées dans le mode de production capitaliste lui-même ? S’il en est ainsi, ceci n’établit-elle pas la nécessité de l’abolition du capitalisme ? Ces questions n’ont rien perdu de leur importance. La raison en tient au fait que, selon les mots de l’éminent historien français Elie Halevy, « La crise mondiale de 1914-18 ne fut pas seulement une guerre — la guerre de 1914 — mais une révolution — la révolution de 1917. » La révolution ne fut pas simplement un produit de la guerre. Elle fut conçue par sa direction comme ouvrant le chemin vers l’avant pour le développement de l’humanité, loin de la barbarie dans laquelle elle avait été plongée par les classes dirigeantes capitalistes.
Les origines de la guerre
La guerre de 1914 et la révolution de 1917 — ce sont là les deux grands évènements qui ouvrirent l’époque historique actuelle et qui dans une grande mesure continuent de la définir. C’est pourquoi nous constatons que, même si le marxisme a été déclaré mort et enterré un millier de fois depuis l’effondrement de l’Union Soviétique, les défenseurs de l’ordre établi se sentent obligés, dans leur analyse des origines de la Première Guerre mondiale, de le déclarer mort pour la mille et unième fois.
Dans son livre sur la Première Guerre mondiale, l’historien britannique Niall Ferguson rappelle la résolution du Congrès de la Seconde Internationale qui se tint à Stuttgart en 1907. « Les guerres entre les Etats capitalistes, » déclarait cette résolution « sont en règle générale le résultat de leur rivalité pour les marchés mondiaux, du fait que chaque Etat est non seulement soucieux de consolider son propre marché mais aussi d’en conquérir de nouveaux… De plus, ces guerres surviennent du fait de la course sans fin aux armements du militarisme… Les guerres sont de ce fait inhérentes à la nature du capitalisme, elles ne cesseront que lorsque l’économie capitaliste sera abolie. » [8]
Selon Ferguson, l’analyse marxiste fut réfutée par les évènements eux-mêmes. « De façon inopportune pour la théorie marxiste » affirme-t-il, il n’y a pratiquement aucune preuve que même la perspective d’avantages économiques « fasse que les hommes d’affaires veuillent une guerre européenne majeure, » alors qu’« à Londres, l’écrasante majorité des banquiers étaient horrifiés de cette perspective, notamment parce que la guerre menaçait de provoquer la banqueroute de la plus grande partie sinon de toutes les principales banques d’escompte engagées dans le financement du commerce international. » [9]
Après avoir cité un certain nombre d’hommes d’affaires et de banquiers opposés à la guerre, Ferguson présente ce qu’il considère comme sa carte maîtresse dans sa réfutation de l’analyse du mouvement marxiste. « Hugo Stinnes un industriel de l’industrie lourde », déclare-t-il, « était si peu intéressé par l’idée d’une guerre qu’en 1914 il créa l’Union Mining Company à Doncaster, avec l’idée d’introduire la technologie allemande dans les mines de charbon anglaises. L’interprétation marxiste des origines de la guerre peut-être mise à la poubelle de l’histoire, en même temps que les régimes qui l’ont le plus vigoureusement soutenue » (nos italiques). [10]
Ferguson adopte la méthode grossière utilisée par tant d’autres avant lui. Selon son opinion, pour que l’analyse du marxisme soit valide nous devrions être en mesure de montrer que les dirigeants politiques prenaient leurs décisions sur la base d’une sorte de calcul des pertes et profits d’intérêts économiques, ou qu’il y avait une cabale d’hommes d’affaires et de financiers opérant dans les coulisses et tirant les ficelles du gouvernement. L’échec à découvrir l’un ou l’autre, soutient-il, coupe l’herbe sous le pied de l’argumentaire marxiste.
Tout d’abord, il faut dire que le choix par Ferguson de Hugo Stinnes en tant que représentant de la nature pacifique de la grande entreprise allemande est un choix plutôt malheureux. Quelques mois à peine après les évènements rapportés par Ferguson, alors que la guerre avait éclaté et que la situation initiale semblait en faveur d’une victoire allemande rapide, Stinnes était au centre de discussions menées dans les milieux gouvernementaux et d’affaires allemands sur des plans d’après-guerre en vue d’un partage de la France — avec comme priorité le détachement de ses ressources en minerai de fer de Normandie pour lesquelles Stinnes avait un intérêt financier considérable.
Comme un historien allemand l’a noté : « A partir du tournant du siècle… en poursuivant sa tendance à l’intégration verticale dans les mines et l’acier, l’industrie lourde commença à étendre son emprise au-delà des frontières de l’Empire allemand, en Belgique et dans le Nord de la France. Les intérêts allemands acquirent progressivement un nombre considérable de holdings majoritaires dans le fer et les mines de charbon de ces régions. Et en effet l’étendue de l’engagement de l’industrie lourde en Belgique et au Nord de la France apparaît quasiment comme une préfiguration des plans d’annexion territoriaux officiels de ces régions qui plus tard firent surface comme faisant partie des buts de guerre allemands pendant la Première Guerre mondiale. » [11]
Ferguson croit avoir réussi sa démonstration contre le marxisme et son analyse que la guerre survient comme un produit inévitable du mode de production capitaliste — la lutte pour les marchés, les profits et les ressources — s’il peut démontrer que les hommes d’affaires et les banquiers ne voulaient pas la guerre, et qu’elle menaçait leurs intérêts.
Mais une telle démonstration, même si elle était réalisée, ne prouverait rien. Le point sur lequel insiste le marxisme n’est pas que la guerre est simplement décidée de façon subjective par la classe capitaliste, mais que, en dernière analyse, elle est le résultat de la logique objective et des contradictions du système de profit capitaliste, qui œuvrent d’elles-mêmes derrière le dos des politiciens et des hommes d’affaires. A un certain moment, ces contradictions créent les conditions dans lesquelles les dirigeants politiques sentent qu’ils n’ont pas d’autre choix que de recourir à la guerre s’ils veulent défendre les intérêts de leurs Etats respectifs.
Si l’on voulait suivre la logique de Ferguson, on pourrait tout aussi bien soutenir que les fluctuations dans le cycle des affaires — en particulier les récessions — ne sont pas non plus un produit des contradictions du système capitaliste. Après tout, aucun dirigeant d’affaire, banquier ou politicien capitaliste ne veut les récessions — elles sont mauvaises autant pour les affaires que pour la politique — et ils font des efforts acharnés pour les éviter. Mais des récessions et effondrements plus graves ne s’en développent pas moins et sont même parfois plus sévères qu’ils ne l’auraient été autrement, précisément à cause des efforts des dirigeants d’affaires et des hommes politiques pour les éviter.
Un autre ouvrage récent sur la Première Guerre mondiale s’en prend aussi au marxisme à propos des origines de la guerre, quoique partant d’une perspective légèrement différente. L’historien anglais Hew Strachan met l’accent sur le rôle crucial du système d’alliance, non seulement pour son échec à éviter la guerre mais en fait pour avoir favorisé sa venue. Quand la crise de juillet 1914 éclata, écrit-il, « chaque puissance, consciente d’une façon égocentrique de ses propres faiblesses potentielles, sentit qu’elle était mise au défi, que son statut en temps que grande puissance serait perdu si elle manquait à agir. »
Strachan insiste à juste titre pour dire que la crise de juillet ne peut pas être envisagée isolément. Les positions adoptées par les principales puissantes étaient elles-mêmes le résultat de crises précédentes et des décisions prises pour les résoudre. « La Russie devait soutenir la Serbie parce qu’elle l’avait déjà fait en 1909, l’Allemagne devait soutenir l’Autriche-Hongrie puisqu’elle avait battu en retraite en 1913 ; la France devait honorer les engagements avec la Russie comme Poincaré l’avait répété depuis 1912 ; le succès apparent de l’Angleterre en matière de médiation encourageait à des efforts renouvelés en 1914. » Néanmoins, la « fluidité » qui avait caractérisé les relations internationales lors de l’éruption de la première crise majeure à propos du Maroc en 1905 avait fait place à une certaine rigidité dans le système international.
« De telles explications », continue Strachan « sont un mélange inélégant de politique et de diplomatie. Les rivalités économiques et impériales, qui sont les facteurs de plus longue portée, aident à expliquer l’augmentation de la tension internationale dans la décennie précédent 1914. La dépression économique encouragea la promotion de la compétition économique sous une forme nationaliste. Mais le commerce était international dans son orientation, l’interpénétration économique était un argument commercial puissant contre la guerre. L’impérialisme comme Bethmann Hollweg tenta de le montrer dans sa poursuite de la détente, traversait les blocs d’alliances. De plus, même si les facteurs économiques sont une aide pour expliquer les causes à long terme, il est difficile de voir quelle est leur place dans la mécanique précise de la crise de juillet. Les cercles commerciaux étaient scandalisés par la perspective de la guerre et l’effondrement du crédit qui devait en découler ; Bethmann Hollweg, le Tsar et Grey envisageaient la dislocation économique et l’effondrement social. Dans le court terme, l’interprétation léniniste de la guerre comme le stade final dans le déclin du capitalisme et de l’impérialisme, de la guerre comme moyen de réguler des déséquilibres économiques externes et de résoudre des crises internes, ne peut pas constituer une explication appropriée des causes de la Première Guerre mondiale. En effet, ce qui demeure frappant à propos de ces chaudes semaines de juillet est le rôle, non de forces collectives ni de facteurs de longue portée, mais de l’individu. » (mes italiques). [12]
Strachan tente de réfuter l’analyse marxiste de la guerre en opposant les facteurs à plus long terme que sont les processus économiques, dont il reconnaît qu’ils sont à l’œuvre, aux décisions individuelles, politiques et diplomatiques, prises par des hommes politiques à court terme. Bien entendu, avec cette méthode, il est facile de démontrer que l’analyse marxiste de n’importe quel événement historique est fausse parce que les décisions sont toujours prises à court terme — le jour du processus à long terme n’arrive jamais, puisque l’histoire est toujours une série d’évènements qui pris en eux-mêmes se déroulent sur une courte période.
Le problème ici ce n’est pas le marxisme, mais le fait d’opposer — le long terme et le court terme, l’économique et le politique — des processus qui sont en réalité une partie d’un tout unifié. L’analyse marxiste du processus historique ne nie pas le rôle de l’individu et de la prise de décision politique. En fait, il insiste sur le fait que les processus économiques qui constituent les forces motrices du processus historique ne peuvent être réalisés que par des décisions conscientes. Cela ne signifie pas non plus que les réactions des hommes politiques soient simplement la réponse automatique ou programmée à des processus économiques. Il n’y a en aucune façon un seul et unique résultat à un ensemble donné de circonstances. En fait, des décisions prises à un certain moment peuvent être critiques pour le cours du développement futur. Mais ce cours sera lui-même, en fin de compte, déterminé par les conséquences de processus économiques à long terme et non pas par les souhaits et les intentions des décideurs.
L’homme, expliquait Marx, prend des décisions, mais pas dans le cadre de conditions de son propre choix. Plutôt, il fait cela dans des circonstances dont il a hérité. Il en va de même des hommes politiques capitalistes et des diplomates.
Comme Strachan lui-même le reconnaît, les décisions qui furent prises lors de la crise de juillet qui conduisit à la guerre furent mises en œuvre dans des conditions qui avaient été façonnées par des décisions précédentes dans des crises antérieures. Mais il n’est pas suffisant de constater cela. Il est nécessaire d’examiner pourquoi ces crises continuaient à se produire. Qu’est-ce qui dans la structure de la politique internationale faisait en sorte que les grandes puissances étaient en permanence placées dans une situation où elles étaient sur le point de faire la guerre ? Cela demande un examen des processus économiques à long terme qui étaient à l’œuvre et de leur relation avec le développement historique de l’économie capitaliste mondiale.
Pour l’Autriche-Hongrie, les questions en rapport avec l’assassinat de l’archiduc Ferdinand concernaient rien moins que la survie de l’empire. Il y avait une claire reconnaissance que l’opportunité devait être saisie de s’occuper de la Serbie et de contenir, sinon de contrecarrer complètement, ses ambitions de jouer le rôle joué par le Piémont dans l’unification de l’Italie et de compléter l’unification nationale des Slaves du Sud. Une répétition de l’expérience italienne signifiait la fin de l’empire, déjà confronté à une marée montante d’opposition de la part des nationalités opprimées à l’intérieur de ses frontières.
La montée de l’opposition nationaliste, contrairement aux conclusions auxquelles aboutissait l’esprit policier, n’était pas seulement le travail d’agitateurs et de démagogues, mais la conséquence du développement des rapports capitalistes dans l’Est et le Sud-est de l’Europe dans les dernières décennies du dix-neuvième siècle.
« La péninsule balkanique », écrivait Trotsky, « était entrée sur le chemin du développement capitaliste, et c’était cela qui faisait de la question de l’autodétermination nationale des peuples balkaniques en temps qu’Etats nationaux le problème historique du jour. » [13]
Mais la route vers l’autodétermination nationale était bloquée par l’existence de l’Empire austro-hongrois. De plus, la survie de l’Empire austro-hongrois n’était pas cruciale que pour les Habsbourg, elle n’était pas de moindre importance pour les classes dirigeantes d’Allemagne. En effet, il a été montré que la séquence des demandes et des ultimatums qui menèrent en fin de compte au déclenchement de la guerre découlèrent de l’insistance de Berlin pour que l’Autriche prenne les mesures nécessaires pour affronter la Serbie.
Après avoir traité d’abord de la question de la propagande pour une grande Serbie et des manœuvres du régime tsariste dans les Balkans, une publication gouvernementale officielle de l’époque explicitait les intérêts stratégiques à long terme de l’Empire germanique qui expliquaient l’insistance de celui-ci pour que l’Autriche-Hongrie mène une action décisive, même au risque de provoquer une guerre.
« L’Autriche, » soulignait ce document, « a été forcée de réaliser qu’il n’était pas compatible avec la dignité et la préservation de la monarchie de regarder ce qui se passait de l’autre côté de la frontière sans réagir. Le gouvernement impérial nous a informé de ses vues et nous a demandé notre avis sur la question. Nous avons pu sincèrement dire à notre allié que nous étions d’accord avec son évaluation de la situation et avons pu l’assurer que toute action qu’il estimerait nécessaire pour mettre un terme au mouvement contre la monarchie autrichienne en Serbie rencontrerait notre approbation. En faisant cela, nous étions bien conscients du fait que d’éventuelles opérations de guerre de la part de l’Autriche-Hongrie pourraient entraîner l’intervention de la Russie et pourrait selon les termes de notre alliance, nous impliquer dans la guerre. »
« Mais compte tenu des intérêts vitaux qui étaient en jeu pour l’Autriche-Hongrie, nous ne pouvions conseiller à notre allié de faire preuve d’une indulgence incompatible avec sa dignité, ou lui refuser un soutien dans un moment d’une telle importance. Nous étions d’autant moins portés à le faire que nos propres intérêts étaient gravement menacés par cette agitation persistante en Serbie. Si les Serbes, aidés par la Russie et la France, avaient été autorisés à continuer à mettre en danger la stabilité de la monarchie dont nous sommes les voisins, ceci aurait conduit à l’effondrement progressif de l’Autriche et à l’assujettissement de toutes les races slaves à la domination russe [et] ceci aurait ensuite rendu la position de la race allemande précaire en Europe centrale. Une Autriche moralement affaiblie, s’effondrant devant l’avancée du panslavisme russe, serait un allié sur lequel nous ne pourrions pas nous appuyer, duquel nous ne pourrions pas dépendre et duquel nous dépendons néanmoins, en face de l’attitude de plus en plus menaçante de nos voisins de l’Est et de l’Ouest. C’est pourquoi nous lui avons donné carte blanche dans son action contre la Serbie. » [14]
Les raisons de l’insistance de l’Allemagne pour que l’Autriche-Hongrie adopte une ligne d’action ferme, même au risque d’une guerre, se trouvent dans le développement historique du capitalisme allemand au cours des quatre décennies précédentes.
A la suite de la formation de l’Empire germanique en 1871, le nouveau chancelier du Reich, Bismarck, déclara que l’Allemagne était une puissance « satisfaite », ne cherchant pas de conquête supplémentaire ou de colonie. La politique de Bismarck visait à maintenir la position de l’Allemagne au sein de l’Europe. Mais la fondation de l’Empire et les processus économiques énormes qu’il libérait signifiait que la balance du pouvoir qui avait prévalu depuis la fin des guerres napoléoniennes se trouvait rapidement remis en question.
En moins de quatre décennies, l’Allemagne passa d’une position de relatif sous-développement en Europe de l’Ouest à la position de deuxième puissance économique industrielle mondiale. Déjà à la fin du siècle, elle avait dépassé la France et contestait la puissance de la Grande-Bretagne dans des secteurs économiques majeurs. Par elle-même, l’expansion de l’économie allemande posait déjà de nouveaux problèmes : l’accès aux matières premières — en particulier le minerai de fer pour la sidérurgie en pleine croissance — et le besoin de s’assurer de nouveaux marchés. De plus, le processus d’industrialisation lui-même provoquait des tensions sociales et politiques à l’intérieur de l’Allemagne entre les trusts industriels en pleine croissance et les Junkers, propriétaires fonciers, et entre la classe ouvrière et les classes possédantes dans leur ensemble.
De plus en plus, à la fin du siècle, l’Empire se révélait trop étroit pour l’expansion rapide du capitalisme allemand dont la formation avait libéré le développement. Une nouvelle orientation et une nouvelle politique étaient nécessaires. Elles se manifestèrent sous la forme de l’adoption d’une Weltpolitik, ou politique mondiale, proclamée par l’empereur Guillaume II en 1897. La politique continentale poursuivie par Bismarck était de plus en plus obsolète à l’époque nouvelle de l’impérialisme, alors que l’Angleterre et la France s’engageaient dans l’acquisition de colonies, amenant de nouvelles ressources sous leur contrôle, avec le danger implicite que les intérêts allemands en seraient exclus.
En mars 1900, le chancelier allemand Von Bülow expliqua au cours d’un débat que ce qu’il entendait par « politique mondiale » était « simplement le soutien et le développement des tâches qui résultent de notre industrie, notre commerce, le pouvoir du travail, l’intelligence et l’activité de notre peuple. Nous n’avons pas l’intention de conduire une politique agressive d’expansion. Nous voulons simplement protéger les intérêts vitaux que nous avons acquis, dans le cours naturel des évènements, partout dans le monde. » [15]
L’idée que l’établissement de l’Allemagne en tant que puissance mondiale était le produit naturel de la formation de l’Empire allemand était une vue largement répandue dans les cercles politiques, des affaires et intellectuels. Elle avait été clairement exposée par Max Weber dans sa conférence inaugurale à Fribourg en 1895. « Nous devons apprécier le fait, » déclarait Weber « que l’unification de l’Allemagne était une espièglerie que s’est offerte la nation dans son vieil âge, et qu’il aurait mieux valu, du fait de son coût élevé, qu’elle ne soit pas menée à bien si elle devait signifier la fin et non le point de départ d’une politique allemande en tant que puissance mondiale. »
Au plus fort de la guerre, dans une conférence tenue le 22 octobre 1916, Weber insistait à nouveau sur la relation entre la formation de l’Empire et l’affrontement qui se déroulait alors en Europe. « Si nous n’avions pas souhaité risquer cette guerre, » soulignait-t-il, « nous aurions pu aussi bien laisser le Reich infondé et demeurer en tant que nation constituée de petits Etats. » [16]
La poursuite d’une Weltpolitik dans la première décennie du siècle fut la cause d’une série de crises internationales au moment où les puissances dominantes cherchaient à faire avancer leurs intérêts. Pour l’Allemagne, il s’agissait d’acquérir une position avantageuse et de s’établir sur la scène internationale, tandis que pour les plus anciennes puissances impérialistes, L’Angleterre et la France, la question centrale devint de plus en plus la nécessité de repousser ce nouveau et dangereux rival.
Mais un peu plus de dix ans après avoir été engagés, la Weltpolitik et son programme de construction navale massif rencontraient une certaine crise. Dans les deux conflits avec la France à propos du Maroc, l’Allemagne avait été mise en échec et lors de la deuxième occasion ne reçut pas même le soutien de son allié austro-hongrois. Les problèmes intérieurs augmentaient eux aussi.
L’une des justifications de la Weltpolitik et de la poursuite d’un programme naval était qu’il procurerait un point de convergence pour forger une identité nationale, ou du moins une unité de toutes les classes de propriétaires et celles de la classe moyenne contre la menace émergente d’une classe des travailleurs organisée. Mais le coût énorme du programme naval avait généré des difficultés de financement. Pendant ce temps, la stabilité du régime était menacée par la croissance de la classe ouvrière, qui se reflétait dans le développement du soutien électoral au Parti social-démocrate (SPD), qui devint le plus grand parti du Reichstag lors des élections de 1912.
Le dirigeant de la ligue pangermanique décrivait l’humeur générale de la façon suivante : « Les [classes] propriétaires et éduquées sentent qu’elles ont été désavouées et réduites au silence par le vote des masses. Les entrepreneurs, qui, à la suite du développement des dernières décennies, sont devenus les piliers de notre économie nationale, se voient exposés au pouvoir arbitraire des classes ouvrières qui sont aiguillonnées par le socialisme. » [17]
L’historien V.R. Berghahn se réfère à un « état de paralysie » qui se développa après 1912 et qui menaçait l’ordre impérial tout entier.
« La paralysie domestique n’était pas un moyen approprié de préservation du statu quo... Une guerre étrangère pouvait-elle agir comme un catalyseur pour rétablir la stabilité de la position de la monarchie prusso-germanique à la fois sur le plan intérieur et extérieur ?… Cette idée n’était pas étrangère à des cercles politiques et militaires influents et les évènements de 1913 avaient fait beaucoup pour renforcer ce type de réflexion. Etant donné leur impression que le temps commençait à manquer, mais aussi leur conscience qu’ils bénéficiaient toujours d’un avantage sur leurs opposants à l’intérieur et à l’extérieur, les élites conservatrices devinrent de plus en plus tentées d’utiliser leur puissance supérieure avant qu’il ne soit trop tard. » [18]
Qu’elles aient ou non consciemment cherché une guerre, il était devenu clair en 1912 pour de larges sections des classes dominantes allemandes que la tentative de se faire « une place au soleil » en se servant de la puissance navale et en forçant les plus anciennes puissances impérialistes à faire des concessions, était plus ou moins arrivé à une impasse. A deux reprises, l’Allemagne avait essayé d’imposer ce qu’elle considérait comme ses droits économiques légitimes vis-à-vis du Maroc, et à deux reprises elle avait subi une rebuffade de la part de l’Angleterre et de la France. Il fallait trouver une nouvelle méthode.
C’était l’arrière-plan de la proposition faite en 1912 par l’industriel Walther Rathenau, le personnage qui dominait dans le combinat de l’électricité et de la mécanique AEG, pour la formation d’un bloc économique, dominé par l’Allemagne, en Europe centrale. Rathenau conçu le plan d’une « Mitteleuropa » (Europe centrale) au Kaiser et à Bethmann Hollweg.
Le volume du commerce de l’Allemagne était le plus élevé au monde et son économie en expansion devenait de plus en plus dépendante de matières premières importées. Mais l’Allemagne, à la différence des Etats-Unis et de l’Angleterre, ses rivaux, avait encore à se tailler une aire de domination économique, comme ceux-ci avaient réussi à le faire dans les Amériques et dans l’Empire britannique. Il fallait que l’Allemagne établisse un bloc économique en Europe centrale qui constituerait la base de son essor en tant que puissance économique.
L’Europe du Sud-est prenait une importance économique croissante. En 1913, plus de la moitié de l’investissement allemand en Europe était concentré dans la région située entre Vienne et Bagdad. Cela représentait près de 40 pour cent de la totalité de l’investissement mondial allemand.
Ce n’était pas que le programme pour la Mitteleuropa dusse remplacer la Weltpolitik. Ce devait plutôt être un moyen de réaliser ces buts dans un contexte où la tentative menée pendant une décennie d’utiliser la puissance navale avait produit peu de résultats.
Comme Rathenau l’expliqua en décembre 1913, « L’occasion d’acquisitions pour la grande Allemagne a été manquée. Malheur à nous qui n’avons rien pris et n’avons rien reçu. » L’Allemagne, revendiquait-il, avait en tant que le plus fort, le plus riche, le plus peuplé et le plus industrialisé des pays d’Europe, une légitime revendication à davantage de territoires. Toutefois, du fait qu’une franche appropriation n’était pas envisageable, la seule alternative était de « s’efforcer de construire une union douanière en Europe centrale que les Etats de l’Ouest finiraient par rejoindre, que cela leur plaise ou non. Cela créerait une union économique qui serait égale voire peut-être supérieure à l’Amérique. » [19]
Regardant en arrière en 1917, Gustav Stresemann, un des dirigeants du Parti national libéral et le porte parole d’intérêts industriels puissants, résumait les préoccupations de secteurs de plus en plus importants de l’industrie allemande :
« Nous étions témoins du fait que d’autres conquéraient des mondes pendant que nous avec notre population qui s’accroissait et avec une économie en développement et un commerce mondial croissant, nous regardions le monde qui se divisait de façon croissante en sphères d’influences, nous découvrions le monde sous le sceptre des autres et les aires géographiques dans lesquelles nous pouvions librement entrer en concurrence et qui étaient indispensables à notre survie, devenir sans cesse plus restreintes. » [20] Les remarques de Stresemann résumaient les sentiments partagés par les milieux politiques et économiques allemands à l’époque du déclenchement de la guerre. L’Allemagne se retrouvait enfermée, militairement, politiquement et économiquement. Il arrivait un moment où elle allait devoir frapper en retour.
La perspective d’une Mitteleuropa dominée par l’Allemagne était au cœur des buts de guerre énoncés par le chancelier Bethmann Hollweg au début de septembre 1914, lorsqu’il semblait qu’une victoire rapide contre la France fût envisageable.
Le but de la guerre, déclarait-t-il, était d’assurer la sécurité de la position de l’Allemagne à l’Est et à l’Ouest « pour toujours ». « A cette fin », poursuivait-il, « la France doit être si affaiblie qu’elle ne puisse s’établir à nouveau comme une grande puissance ; la Russie doit être repoussée de la frontière allemande aussi loin que possible et sa domination sur les peuples vassaux non russes doit être brisée. »
La France devrait céder les champs miniers de Briey, nécessaires à la fourniture de minerai pour « notre industrie » et forcée à payer une indemnité de guerre « suffisamment élevée pour [l’]empêcher de dépenser aucune somme considérable en armement pendant les 15-20 prochaines années. »
Bethmann Hollweg continuait ainsi : « De plus, établir un traité commercial qui rendra la France dépendante économiquement de l’Allemagne, garantira le marché français pour nos exportations et rendra possible d’exclure le commerce anglais de la France. Ce traité doit nous assurer une liberté de mouvement industriel et financier en France de telle façon que les entreprises allemandes ne puissent plus être traitée différemment des entreprises françaises. »
La Belgique si elle était autorisée à continuer à exister en tant qu’Etat, devait être réduite à un Etat vassal, avec son littoral mis à la disposition de l’armée allemande et réduite économiquement au statut d’une province allemande. Le Luxembourg deviendrait un Etat fédéral allemand et recevrait des portions du territoire belge.
« Nous devons créer une association économique en Europe centrale par l’intermédiaire d’un traité douanier commun, pour y inclure la France, la Belgique, la Hollande, le Danemark, l’Autriche-Hongrie, la Pologne et peut-être l’Italie, la Suède et la Norvège. Cette association n’aura aucune autorité suprême constitutionnelle et tous ses membres seront officiellement égaux, mais en pratique seront sous la direction de l’Allemagne et devront stabiliser la suprématie allemande sur la Mitteleuropa. » [21]
L’historien britannique James Joll reconnaît l’importance du programme de la Mitteleuropa dans la définition des buts de guerre allemands après le déclenchement du conflit, mais soutient que l’on ne peut pas affirmer qu’ils furent un facteur incitant au déclenchement de la guerre.
« Certains doutes demeurent quant à savoir jusqu’où un programme conçu après le déclenchement de la guerre est forcément une preuve concernant le processus de décision ayant mené à la guerre deux mois plus tôt. Nous ne saurons jamais ce qu’il y avait vraiment dans les pensées de Bethmann et de ses collègues en juillet 1914 ou comment ils définirent les priorités parmi les nombreuses considérations qui devaient être prises en compte. De savoir s’ils ont vraiment déclaré la guerre de façon à réaliser ces buts économiques et géopolitiques ou pour un nombre de raisons plus immédiates ne pourra jamais être tranché. Ce qui est certain c’est que dès que la guerre fut déclenchée, la plupart des belligérants commencèrent à penser aux gains qu’ils pourraient tirer en cas de victoire. Les Anglais pensèrent à écarter la compétition commerciale et industrielle allemande pour de nombreuses années tout comme à mettre fin à la menace posée par la marine allemande. Les magnats français du fer et de l’acier du Comité des Forges commencèrent comme leurs homologues allemands à penser aux gains territoriaux qui leurs assureraient le contrôle de leurs matières premières. Les Russes eurent aussitôt l’idée d’une avancée sur Constantinople pour obtenir le contrôle permanent de la sortie de la Mer Noire. Il y a peut-être une distinction à faire entre les buts de guerre pour lesquels un pays va faire la guerre et les buts de paix, les conditions auxquelles il pense consentir la paix une fois la guerre commencée et une fois que la victoire semble en vue. » [22]
Le but de ces subtiles distinctions, pour ne pas parler de l’art de couper les cheveux en quatre, est de démentir la thèse marxiste que les forces directrices de la guerre étaient enracinées dans les conflits économiques et géopolitiques des principales puissances capitalistes.
En ce qui concerne l'Allemagne, la guerre, comme le souligne Fritz Fisher, n'a créé aucun nouvel objectif de guerre « mais elle a soulevé des espoirs de réaliser les objectifs anciens qui avaient été poursuivis en vain par des moyens politiques et diplomatiques avant la guerre. La guerre était ressentie comme une libération des limites de l'ordre d'avant-guerre, non seulement dans le domaine des politiques internationales mais aussi dans la sphère économique et domestique. » [23]
Selon Joll toutefois, puisqu'il est impossible de savoir exactement ce qu'il y avait exactement dans l'esprit de Bethmann Hollweg — ou dans celui des hommes politiques en Angleterre, en Russie et en France — dans les jours du mois de juillet, nous ne pouvons pas soutenir que la guerre était en dernière analyse enracinée dans les forces économiques qui furent clairement mises en évidence après le déclenchement de la guerre.
En opposition à cette méthode, considérons l’approche retenue par un autre historien, qui n’est pas du tout marxiste, qui a considéré qu’il était indispensable d’insister sur les forces qui agissaient de façon sous-jacente. « Je ne tiendrai pas compte des suggestions faites rétrospectivement par une multitude de critiques bien intentionnés, » écrivit Elie Halevy, « sur ce que tel ou tel souverain, premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, aurait du faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire tel et tel jour, ou à telle et telle heure, de façon à prévenir la guerre. Ce sont là des comprimés pour en finir avec un tremblement de terre ! L’objet de mon étude est le tremblement de terre lui-même. »[24]
Le fait que des hommes politiques attribuent à divers moments des motivations différentes à leurs actions ne signifie pas que nous ne puissions pas établir les causes de la guerre. Plutôt, cela montre que dans le cours même de la guerre — comme dans toute grave crise sociale — les raisons et les motivations accidentelles sont repoussées de plus en plus à l’arrière-plan et les forces motrices — qui peuvent même être restées cachées à ceux qui prennent les décisions — se manifestent plus clairement au premier plan. Pour déclencher la guerre, il a fallu prendre des décisions conscientes. Mais cela ne signifie pas du tout que ceux qui furent impliqués dans la prise de décisions aient été nécessairement conscients de tous les processus économiques et historiques qui les avaient mis dans la position où ils ne voyaient plus d’autre alternative que les actions qu’ils ont entreprises.
La montée du capitalisme allemand et la crise européenne
L’accent mis jusqu’ici sur le rôle de l’Allemagne ne devrait pas être interprété comme signifiant que l’Allemagne ait été en quoi que ce soit davantage responsable de la guerre que les autres grandes puissances et que de ce fait, elle ait été à juste titre déclarée « responsable de la guerre » comme cela fut décrété par le Traité de Versailles. Une concentration sur l’Allemagne découle en fait de l’économie politique des relations internationales au tournant du siècle. Par-dessus tout, c’était le développement dynamique du capitalisme allemand ayant suivi la formation de l’empire en 1871, qui avait remis en question l’équilibre du pouvoir en Europe.
L’Allemagne cherchait à faire évoluer le statu quo en rapport avec le développement de son industrie et à faire avancer ses intérêts économiques et géopolitiques. Mais ce faisant, elle entra en conflit avec les autres grandes puissances qui étaient satisfaites de ce statu quo, qui en tiraient de grands bénéfices et qui étaient tout aussi décidées à le préserver que l’Allemagne à le changer.
La décision de l’Allemagne de prendre prétexte des évènements de Sarajevo en juillet 1914 pour consolider sa position en Europe du Sud-est et de déclencher une épreuve de force avec la Russie, la France, alliée de la Russie, et même avec l’Angleterre si cela s’avérait nécessaire, était motivée par les inquiétudes selon lesquelles il était nécessaire d’agir face à une situation internationale et domestique qui s’aggravait.
Quant à la France, l’éruption d’une guerre dans toute l’Europe était la seule voie par laquelle elle pouvait restaurer sa position sur le continent européen. La domination française au dix-neuvième siècle avait dépendu de la désunion des Etats allemands. Mais la guerre franco-prussienne et l’unification de l’Allemagne avaient signifié que la France dépendait d’alliances avec d’autres puissances contre sa rivale plus puissante.
Avec l’annexion allemande de l’Alsace-Lorraine à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870-71, Marx avait insisté sur l’inévitable alignement de la France avec la Russie, considérée comme impensable à l’époque du fait de la très grande différence entre les systèmes politiques des deux pays. « Celui qui n’est pas rendu sourd par le tumulte de l’instant », écrivait-il « et n’a pas un intérêt à assourdir le peuple allemand, doit voir que la guerre de 1870 portait en elle, par nécessité, une guerre entre l’Allemagne et la Russie, tout comme la guerre [austro-prussienne, ndt] de 1866 portait en elle la guerre de 1870. Je dis, par nécessité, à moins que l’improbable ne survienne, à moins qu’une révolution n’éclate en Russie avant cela. Si ce n’est pas le cas, une guerre entre l’Allemagne et la Russie peut même déjà être considérée comme un fait accompli [en français dans le texte, ndt]. Il dépend entièrement de l’attitude des vainqueurs actuels de déterminer si cette guerre a été utile ou dangereuse. S’ils prennent l’Alsace-Lorraine, alors la France avec la Russie s’armera contre l’Allemagne. Il est superflu d’en montrer les désastreuses conséquences. » [25]
Non pas que la France ait été conduite à la guerre avec l’Allemagne seulement par un désir de revanche. Durant les quatre décennies qui ont suivi l’annexion, d’autres facteurs étaient entrés en jeu. La lutte avec l’Allemagne avait dépassé les limites de l’Europe du fait que les deux puissances cherchaient à établir des colonies et des sphères d’influence à travers le globe.
En considérant rétrospectivement la crise de juillet, le président français, Poincaré, exprimait clairement les enjeux stratégiques qui étaient liés à la décision de soutenir la Russie et de refuser l’exigence de l’Allemagne que la France reste neutre.
« Sur nous reposaient deux devoirs, difficiles à concilier mais également sacrés : faire tout notre possible pour prévenir un conflit, et faire tout notre possible pour que, s’il devait éclater malgré nos efforts, nous soyons prêt à y faire face. Mais il y avait également deux autres devoirs, qui à certains moments courraient le risque d’être mutuellement contradictoires : ne pas briser une alliance sur laquelle la politique française s’était appuyée depuis un quart de siècle et dont la rupture nous laisserait isolés et à la merci de nos rivaux ; et néanmoins faire ce qui était en notre pouvoir pour inciter nos alliés à faire preuve de modération dans des affaires dans lesquelles nous étions beaucoup moins directement impliqués qu’eux-mêmes. » [26]
La décision de Londres d’entrer en guerre aux côtés de la France et de la Russie contre l’Allemagne était de la même façon motivée par des considérations stratégiques à long terme, par dessus tout la croyance qu’à un certain moment l’Angleterre aurait à s’opposer frontalement à l’Allemagne et que plus longtemps elle diffèrerait la confrontation, pire serait la position de l’Angleterre.
Pourquoi un modus vivendi ne pouvait-il être trouvé entre l’Angleterre et l’Allemagne ? L’histoire et la raison semblaient indiquer cette direction. Après tout les deux nations n’étaient jamais entrées en guerre dans le passé, partageaient de nombreux intérêts communs et avaient développé des relations économiques plus étroites — elles constituaient des marchés majeurs pour leurs productions respectives. Néanmoins l’ascension de l’Allemagne menaçait sans cesse d’avantage la position mondiale de l’Angleterre.
Près de 20 ans avant la crise de juillet, le secrétaire aux affaires étrangères Edward Grey avaient résumé ses vues sur la montée de l’Allemagne de la façon suivante : « Le fait est que le succès du parcours de l’Angleterre a mis de mauvaise humeur à notre égard le reste de la planète et maintenant qu’en Europe ils ont cessé de se quereller pour des provinces et ont tourné leur regard vers des endroits plus éloignés, ils nous trouvent partout sur leur chemin. D’où une tendance générale à nous considérer comme une nuisance et à s’allier contre nous. J’ai peur que nous ayons à nous battre tôt ou tard, à moins qu’une pomme de discorde européenne ne tombe au milieu des puissances du continent… » [27]
Les dirigeants politiques britanniques pouvaient reconnaître le besoin allemand d’expansion planétaire, du moins dans l’abstrait. Néanmoins, selon les mots d’un mémorandum préparé le 1er janvier 1907 par Eyre Crowe, directeur de cabinet au Foreign Office, il fallait que les Britanniques fassent preuve « de la plus inflexible détermination à défendre les droits et les intérêts britanniques partout dans le monde ». [28]
Ce mémorandum contenait une discussion approfondie des considérations stratégiques devant guider la politique étrangère anglaise par rapport à l’Allemagne et à ses prétentions croissantes à un statut de puissance mondiale. Selon Crowe, soit l’Allemagne visait à une domination politique et maritime générale, ou alors elle n’avait pas une ambition aussi clairement définie, mais visait seulement à utiliser légitimement sa position pour promouvoir son commerce extérieur et étendre l’influence de la culture allemande ainsi qu’à se créer de nouveaux intérêts commerciaux partout dans le monde, dans les endroits et les moments où une opportunité se présentait pour y parvenir de façon pacifique.
Comment serait-on en mesure de faire la différence entre les deux cas ? Il n’y avait en fait pas nécessité à se déterminer sur le sujet, expliquait Crowe, parce que les conséquences pour l’Angleterre seraient identiques. Le deuxième plan « pouvait à n’importe quel étape se fondre dans le plan initial ou conscient » et « si jamais le plan d’une évolution pacifique venait à se réaliser, les positions accumulées par l’Allemagne constitueraient de façon évidente une formidable menace pour le reste du monde, similaire à celle que représenterait un processus de conquête délibéré des mêmes positions par ‘malveillance préméditée’ ».
L’importance du mémorandum de Crowe tient à ce qu’il attire l’attention sur les processus objectifs et les tendances à l’œuvre dans les relations anglo-allemandes. Quelles que soient les politiques poursuivies par ses élites politiques et quelles que soient ses intentions, Crowe maintenait qu’en elle-même l’avance économique de l’Allemagne et l’expansion subséquente de ses intérêts sur une échelle mondiale représentait un danger pour l’empire anglais qui devait être contrecarré.
Tout en ne déniant pas la légitimité de l’expansion de l’Allemagne, concluait-il, il fallait veiller à « indiquer clairement que cette attitude bienveillante sera remplacée par une opposition déterminée au premier signe indiquant que les intérêts de l’Angleterre ou de ses alliés seraient menacés ». Une route qui devait être abandonnée, si le passé devait instruire, c’était « la route pavée de généreuses concessions britanniques — des concessions faites sans aucune conviction, ni de leur équité ni de ce qu’elles étaient compensées par des services équivalents. Les vains espoirs que de cette manière l’Allemagne puisse être rendue ‘conciliante’ et plus amicale doivent être définitivement abandonnés. »
Sur le continent européen, l’Angleterre demandait le maintien de « l’équilibre des puissances ». Mais cet « équilibre » était perturbé par l’expansion capitaliste elle-même. L’Allemagne cherchait à développer ses intérêts, tout comme la Russie, qui avait connu une croissance rapide dans les dernières années du dix neuvième siècle et la première décennie du vingtième. L’Italie était une nouvelle force sur le continent, tandis que les vieux empires turques et austro-hongrois étaient dans un état de déclin avancé.
Indépendamment des politiques menées par les différents gouvernements, l’équilibre des puissances dans la vieille Europe était irrémédiablement rompu. Au même moment, l’expansion allemande dans une quelconque partie du monde entrait inévitablement en conflit avec l’Empire britannique. La logique d’une politique qui cherchait à maintenir le vieil équilibre du pouvoir couplé avec « l’inflexible détermination » de maintenir les intérêts britanniques dans toutes les parties de la planète était celle du conflit militaire.
Et en effet, comme Churchill le reconnut dans un moment de candeur durant le débat de 1913-14 sur la politique navale : « Nous avons obtenu tous les territoires que nous voulions, et notre prétention à profiter sans contestation possible de vastes et splendides possessions, le plus souvent acquises par la violence, dans une large mesure préservées par la force, paraît souvent moins raisonnable à autrui qu’à nous-mêmes. » [29]
L’Angleterre était déjà intervenue aux côtés de la France dans la première crise marocaine de 1905. Avec le déclenchement de la deuxième crise en 1911, la nature des différents devint encore plus claire. Au Foreign Office, Crowe définit la question en terme d’équilibre du pouvoir en Europe.
« L’Allemagne », écrivait-il dans un compte-rendu du Foreign Office, « joue très gros. Si ses exigences sont satisfaites que ce soit au Congo ou au Maroc, ou — ce qu’elle va essayer d’obtenir, selon moi — dans les deux régions à la fois, cela signifiera la sujétion définitive de la France. Les exigences posées ne sont pas celles qu’un pays ayant une politique étrangère indépendante puisse accepter. Les détails des conditions ne sont pas si importants pour le moment. Tout cela constitue une épreuve de force et rien d’autre. Faire des concessions ne signifie pas qu’une perte de certains intérêts ou de prestige. Cela a le sens d’une défaite avec toutes ses inévitables conséquences. » [30]
Cette opinion sur la crise marocaine étaient largement partagée. Selon Sir Arthur Nicholson, le sous-secrétaire d’Etat permanent au Foreign Office, si l’Allemagne obtenait ce qu’elle demandait, alors « notre politique consistant depuis 1904 à préserver l’équilibre et par voie de conséquence la paix en Europe » s’effondrera. Le soutien britannique à la France tenait à la peur que si l’Entente s’effondrait, la France pourrait évoluer vers un arrangement avec l’Allemagne, avec le risque d’un isolement de l’Angleterre.
Pour l’Angleterre, le déclenchement de la crise de juillet constituait le point culminant d’un conflit qui s’était développé durant les quinze années précédentes. A moins que l’Allemagne ne renonce à ses exigences de transformation de l’ordre européen et international ou que l’Angleterre n’accepte de profonds changements dans ce domaine, le conflit était inévitable. Mais aucun des protagonistes ne pouvait changer de position parce que l’enjeu n’était pas les desseins, le prestige ou les principes défendus par les hommes politiques, mais les intérêts économiques fondamentaux des Etats dont ils représentaient les intérêts.
Un livre récent passant en revue les décisions qui menèrent les grandes puissances à entrer en guerre concluait que les intérêts de la classe capitaliste n’avaient pas la moindre influence. Les industriels britanniques avaient très peu d’influence sur l’élite définissant les politiques, et les grands financiers de la City de Londres étaient terrifiés par la guerre, croyant qu’elle amènerait la ruine économique. « Quels que soient les motifs de la déclaration de guerre anglaise de 1914, cela n’avait pas pour origine les souhaits des capitalistes de la finance. » [31]
Et pourtant, la décision d’entrer en guerre fut décidée pour la défense de la position de l’Empire britannique, qui, à son tour, était la fondation de la suprématie du capitalisme financier britannique. Une décennie avant le déclenchement de la guerre, le politicien Tory Joseph Chamberlain avait expliqué aux banquiers de la City, en termes dépourvus d’ambiguïté, l’importance de l’Empire pour leurs activités.
« Vous êtes la chambre de compensation du monde », leur dit-il. « Pourquoi ? Pourquoi prospérez-vous dans la banque ? Pourquoi une lettre de change de Londres est-elle la monnaie de référence de toutes les transactions commerciales ? N’est-ce pas du fait de l’énergie et des capacités de production qui en sont la contrepartie ? N’est-ce pas parce que nous avons jusqu’à présent, de toutes les manières, continuellement créé de nouvelles richesses ? N’est-ce pas à cause de la multiplicité, de la variété et de l’étendue de nos transactions ? Si une seule de ces choses essuie un échec, croyez-vous que vous ne le ressentirez pas ? Imaginez-vous que vous pourrez dans ce cas maintenir la situation dont vous tirez une fierté légitime ? Supposez — si une telle supposition est admissible — que vous n’ayez plus les relations que vous avez actuellement avec nos nombreuses colonies et dépendances, avec l’Inde, avec les pays neutres de la planète, seriez-vous encore cette chambre de compensation mondiale ? Non messieurs. Au moins nous pouvons reconnaître ceci — que la prospérité de Londres est intimement liée à la prospérité et à la grandeur de l’Empire dont elle est le centre. » [32]
Et le pivot sur lequel tournait l’Empire, c’était l’Inde. L’attachement britannique à l’Inde ne se fondait pas sur une recherche mal définie de la puissance pour elle-même. Il n’était pas non plus fondé sur des facteurs psychologiques. L’Inde jouait un rôle central et toujours plus important en fournissant simultanément les fondations du pouvoir économique et militaire britannique. Comme le vice-roi de l’Inde Lord Curzon l’expliquait en 1901 : « Aussi longtemps que nous règnerons sur l’Inde nous demeurerons la première puissance mondiale. Si nous la perdons nous dégringolerons aussitôt au statut d’une puissance de troisième ordre. » [33]
Dès le début de la colonisation, l’Inde avait joué un rôle crucial de pourvoyeur financier pour le capitalisme anglais. Dans les dernières décennies du dix-neuvième siècle, avec la montée de puissances industrielles rivales (Allemagne et Etats-Unis) et la compétition accrue pour les marchés, ce rôle devint encore plus important. L’Angleterre avait depuis longtemps un déficit de sa balance commerciale de marchandises — la différence entre les importations et les exportations. Mais cela avait été plus que compensé par le surplus de ce qu’on appelle les invisibles [Balance des services et transferts privés, ndt] — une catégorie dans laquelle on trouve par exemple le fret et les assurances. Néanmoins, vers la fin du dix neuvième siècle, même ces revenus devenaient insuffisants et la stabilité de la finance britannique en vint à reposer de plus en plus sur les revenus des investissements et le revenu des dénommées « Home charges » prélevées sur l’Inde [frais d’administration imposés à l’Inde par l’Empire britannique, ndt]
Le marché indien absorbait une large proportion des exportations britanniques, pendant que dans le même temps, l’Inde générait un surplus commercial avec le reste du monde — qui augmenta de 4 millions £ à 50 millions £ au cours de la deuxième moitié du dix neuvième siècle — lequel était ensuite siphonné par l’intermédiaire des charges payées à l’Angleterre. Selon les mots d’une étude, avant la Première Guerre mondiale « la clé de l’ensemble des circuits de paiement britanniques résidait en Inde, qui se trouvait financer plus des deux cinquièmes du total des déficits anglais ». [34]
Mais alors même que l’Angleterre devenait plus dépendante de l’Inde, grandissait aussi la menace vis-à-vis de sa domination sur cette colonie et sur la stabilité plus générale de l’Empire. La guerre des Boers (1899-1902) fut un choc pour l’establishment britannique. Ce qui devait être un conflit de courte durée — ce sera fini pour Noël — traîna pendant plus de deux ans et eut un coût très élevé tant par le nombre d’hommes perdus que par l’argent dépensé.
Elle mit en évidence l’affaiblissement de la situation militaire de l’Angleterre, qui pouvait certainement être mise à profit par ses rivaux sur le continent européen. Des conclusions politiques claires en furent tirées. La politique étrangère britannique ne pouvait plus longtemps être guidée par le « splendide isolement » qui l’avait caractérisée au dix-neuvième siècle. Dans les cinq années suivant la guerre des Boers, une série de dispositions furent mises en œuvre dans le but de renforcer le contrôle de l’Angleterre sur l’Empire.
Il y eut d’abord l’alliance avec le Japon en 1902, et ensuite le règlement de différents avec la France sur des questions coloniales via l’Entente de 1904, un processus qui fut répété avec l’Entente de 1907 avec la Russie. Dans le cas de l’Entente avec la France, le contrôle anglais sur l’Egypte, la clé pour le contrôle du Moyen-Orient et la route pour l’Inde, fut reconnu, et il y eut avec la Russie reconnaissance explicite de la prédominance de l’Angleterre en Afghanistan et la fin de la menace russe sur l’Inde par le nord.
Si ces mesures furent entreprises pour renforcer l’emprise de l’Angleterre sur son empire, elles eurent pour effet d’entraîner celle-ci dans les conflits sur le continent européen.
La guerre et la révolution russe
Dans son analyse de la guerre, James Joll, notant les déclarations de la Seconde Internationale selon lesquels les guerres sont inhérentes à la nature du capitalisme et cesseront seulement quand l’économie capitaliste sera remplacée, reconnaissait que cette doctrine, si elle était vraie, « fournirait l’explication la plus complète du déclenchement de la Première guerre mondiale, bien qu’elle laisserait ouverte la question de savoir pourquoi cette guerre particulière avait commencé à ce moment particulier de la crise montante du capitalisme. » [35]
L’analyse marxiste de la guerre cependant, ne cherche pas à établir exactement pourquoi la guerre éclata au moment particulier où elle le fit, comme si les contradictions du système capitaliste opéraient avec une sorte de déterminisme de fer qui excluait la chance et l’accident. Au contraire, le marxisme insiste sur le fait que les lois du capitalisme exercent leur influence non pas directement, mais plutôt à travers l’accidentel et le contingent.
Dans le cas de la Première Guerre mondiale, il est clair que, sans la circonstance accidentelle de l’assassinat de l’archiduc autrichien, la crise ne se serait pas développée comme elle le fit. Même après l’assassinat, il n’était en aucune manière prédéterminé que la guerre en résulterait. Mais il n’y a pas de doute que même si la guerre avait été évitée, les tensions croissantes résultant de processus historiques à long terme, de plus en plus évidentes depuis le début du siècle, auraient conduit, plutôt tôt que tard, au déclenchement d’une autre crise.
Si l’analyse marxiste ne prétend pas que le déclenchement de la guerre en août 1914 ait été prédéterminé, elle maintient que des transformations très profondes dans l’économie mondiale chargeaient d’énorme tension des crises politiques et des conflits internationaux pour lesquels il existait plus que suffisamment de combustible.
L’année 1913 constitue un moment critique dans la courbe à long terme du développement capitaliste. Les 15 années précédentes avaient vu la croissance économique la plus soutenue dans l’histoire du capitalisme à cette date. Il y avait des crises et des récessions, mais elles étaient de courte durée et suivies d’une croissance encore plus rapide une fois passées. Mais en 1913, il y avait des signes clairs d’un retournement majeur de l’économie internationale.
L’importance de ce retournement de l’économie mondiale peut être mesurée par un examen des statistiques commerciales. Si l’on prend comme base l’année 1913 avec un index de 100, le commerce mondial dans les années 1876-1880 était seulement de 31,6, croissant à 55,6 dans les années 1896-1900. Cela signifie que dans les 13 années suivantes, il doubla presque. Toutes les puissances capitalistes les plus importantes devenaient de plus en plus dépendantes du marché mondial et sensibles à ses mouvements, dans des conditions où la lutte concurrentielle entre elles devenait plus intense.
Comme Trotsky devait le souligner, le retournement économique de 1913 eut un impact significatif sur les relations politiques entre les grandes puissances parce que ce n’était pas simplement une fluctuation périodique du marché, mais signifiait un changement de la situation économique de l’Europe.
« Une continuation du développement des forces productives à un rythme similaire à celui observé en Europe pendant la quasi-totalité des deux dernières décennies était extrêmement difficile. Le militarisme ne se développe pas seulement parce que le militarisme et la guerre créent un marché, mais aussi parce que le militarisme est un instrument historique de la bourgeoisie dans sa lutte pour l’indépendance, pour sa suprématie et ainsi de suite. Il n’est pas accidentel que la guerre ait commencé dans la seconde année de la crise qui révélait les grandes difficultés du marché. La bourgeoisie sentait la crise par l’intermédiaire du commerce, de l’économie et de la diplomatie… Cela créait une tension de classe, exacerbée par la politique, et cela conduisit à la guerre en août 1914. » [36]
Ce n’est pas que la guerre ait mis un arrêt au développement des forces productives. Plutôt, à partir de 1913, la croissance des forces productives se heurta aux barrières imposées par l’économie capitaliste. Cela signifiait que le marché était divisé, que la compétition était « exacerbée au plus haut point et que désormais les pays capitalistes ne pouvaient réussir à éliminer leurs concurrents du marché seulement par des moyens mécaniques. » [37]
Le retournement de 1913 n’était pas simplement une fluctuation du marché — une récession prenant place au milieu d’un mouvement général de progression de la courbe à long terme du développement capitaliste. C’était un tournant dans la courbe elle-même. Même s’il n’y avait pas eu de guerre en 1914, la stagnation économique se serait installée, accroissant les tensions entre les puissances capitalistes majeures et rendant plus probable l’éclatement d’une guerre dans le futur proche.
Que le retournement de 1913 n’était pas une récession ordinaire est indiqué par le fait qu’après la fin de la guerre, l’économie européenne ne retrouva jamais les conditions de la décennie ayant précédé la guerre. D’ailleurs, dans le contexte de la stagnation économique générale des années 1920 (la production dans de nombreux secteurs ne retrouva ses niveaux de 1913 que vers 1926-27) la période d’avant-guerre en vint à être considérée comme une belle époque [en français dans le texte, ndt] qui ne pourrait jamais revenir.
Afin de mettre en lumière quelques-unes des questions fondamentales de perspective au centre des controverses qui entourent la Première Guerre mondiale, je souhaiterais faire la critique du travail d’un universitaire anglais, Neil Harding. Dans son livre Leninism, Harding trouve que les théories de Lénine n’étaient pas le résultat de conceptions politiques attardées résultant de la situation russe — comme cela est si souvent affirmé en ce qui concerne Que faire ? par exemple — mais étaient « authentiquement marxistes » et avaient effectivement revitalisées le marxisme comme théorie de la révolution. C’est précisément parce que le léninisme représente un marxisme authentique que, selon Harding, il est nécessaire de le réfuter.
Harding maintient que le déclenchement de la guerre et la trahison des dirigeants de la Seconde Internationale convainquirent Lénine de ce « [qu’] il avait une responsabilité unique de réaffirmer l’impératif marxiste d’une révolution à l’échelle mondiale, et de la reformuler dans les conditions économiques et politiques du monde moderne. » [38]
Contrairement à tous ceux qui cherchent à peindre Lénine comme une sorte d’opportuniste qui s’engagea dans une prise de pouvoir dans le chaos produit par la guerre en s’appuyant sur les revendications populaires pour le pain, la paix et la terre, Harding écrit que la réponse de Lénine à la guerre fut de construire une « explication marxiste de la nature du capitalisme contemporain et de comment celui-ci avait, par nécessité, produit le militarisme et la guerre. » Cette explication, qui est intégrée dans son livre L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, « définissait les caractéristiques globales de ce qui était considéré comme une époque entièrement nouvelle de l’histoire humaine — l’époque de l’effondrement final du capitalisme et l’avènement du socialisme » et elle fournissait la fondation théorique pour la révolution menée par les bolcheviks en octobre 1917. [39]
Harding montre de façon correcte que dans la période précédent la guerre, les différentes écoles révisionnistes avaient soutenu que la révolution était une stratégie à la fois peu plausible et inutile et que, au moins entre leurs mains, « en tant que théorie et pratique de la transformation révolutionnaire, le marxisme était virtuellement mort vers 1914. » Il écrit : « C'est Lénine qui, presque à lui tout seul, le fit revivre, à la fois en tant que théorie révolutionnaire et en tant que pratique révolutionnaire ; la théorie de l'impérialisme était par excellence la pierre de touche de toute cette entreprise. » [40]
Il montre que, pour ce qui est des évènements de la Révolution russe, le point de vue de Lénine fut rejeté dès le départ. Quand Lénine avait avancé la possibilité de la révolution socialiste et la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière, il avait rencontré l'opposition non seulement des dirigeants de toutes les autres tendances politiques, mais aussi celle de ses plus proches associés au sein de son propre parti. La Pravda insistait sur le fait que les Thèses d'avril correspondaient aux vues personnelles de Lénine, et qu'elles étaient inacceptables, car elles découlaient « de l'hypothèse que la révolution démocratique bourgeoise est terminée et comp[taient] sur la transformation immédiate de cette révolution en révolution socialiste. » Néanmoins, partant d'une minorité constituée de lui seul en avril 1917, Lénine allait devenir, en novembre, le dirigeant du premier Etat ouvrier.
Pour Harding, le vice fondamental de la perspective proposée par Lénine tient au fait que le capitalisme continua de survivre, en dépit des affirmations faites dans L'impérialisme. Cela s'avéra n'être ni le plus haut point, ni le stade final du développement capitaliste.
« La persistance même, l'adaptabilité et la vitalité persistante du capitalisme ne pouvaient pas être expliquées par la logique du léninisme. Le trait principal de son système de pensée qui rendait l'ensemble intelligible était... l'argument qu'en 1914 le capitalisme était moribond, qu'il ne pouvait plus continuer de se reproduire lui-même, son temps était révolu. Il était tout à fait évident que plus longtemps le capitalisme survivait à ce pronostic, plus l'évidence empirique sapait la métaphysique léniniste de l'histoire. » [41]
Lénine caractérisait assurément l'impérialisme comme le « stade suprême du capitalisme » et comme la « veille » de la transformation socialiste, et il n'envisageait certainement pas que le capitalisme survivrait jusqu'au vingt et unième siècle. La perspective qui guidait la révolution était-elle donc fausse ? La confusion qui règne sur cette question est grande, tant parmi ceux qui soutiennent la perspective de Lénine que parmi ceux qui la dénoncent.
Par exemple, quand nous avons expliqué que la mondialisation représentait un développement supplémentaire d'un point de vue qualitatif de la socialisation de la production, nous avons été attaqués par les spartakistes et d'autres groupes radicaux qui nous ont accusés de rejeter Lénine. Si l'impérialisme était « le stade suprême » du développement capitaliste, alors comment pouvions-nous parler de la mondialisation comme étant un développement qualitatif dans la socialisation de la production ?
Ensuite il y a ceux qui soutiennent que l'analyse de Lénine est réfutée par le fait que le capitalisme a subi d'importants changements depuis la rédaction de L'impérialisme et que depuis cette date un important développement des forces productives était intervenu. Comment alors est-il possible de parler de l'impérialisme comme du stade suprême du capitalisme ? Et cela ne signifie-t-il pas que la Révolution russe elle-même était une tentative prématurée de renverser l'ordre capitaliste et de commencer la transformation socialiste ? C'est-à-dire qu'elle était vouée à l'échec depuis le commencement parce que le capitalisme n'avait pas épuisé son potentiel progressiste.
Tout d'abord, Lénine n'avait pas la conception mécaniste qu’on lui impute si souvent. Au début, il parla de l'impérialisme comme de la « dernière phase » du développement capitaliste. Il le caractérisait certainement comme un capitalisme « décadent » et « moribond ». Mais il faisait remarquer que ce serait « une erreur de croire que cette tendance à la putréfaction exclut la croissance rapide du capitalisme ; non, telles branches d'industrie, telles couches de la bourgeoisie, tels pays manifestent à l'époque de l'impérialisme, avec une force plus ou moins grande, tantôt l'une tantôt l'autre de ces tendances. Dans l'ensemble, le capitalisme se développe infiniment plus vite qu'auparavant, mais ce développement devient généralement plus inégal, l'inégalité de développement se manifestant en particulier par la putréfaction des pays les plus riches en capital (Angleterre). » [42]
Lénine caractérisait les activités du capital anglais, vivant de ses revenus d'exportation de capitaux — le processus du « poinçonnage des coupons », comme l'expression du parasitisme et du déclin dans le pays le plus riche en capital. On peut se demander ce qu'il aurait eu à dire des activités de sociétés comme Enron et WorldCom, du pillage associé aux activités boursières et de la bulle spéculative Internet [bulle spéculative sur les « valeurs technologiques » qui a éclaté au cours de l’année 2000, ndt].
L’impérialisme de Lénine face à « l’ultra impérialisme » de Kautsky
L’analyse de Lénine, tant dans L’impérialisme que dans ses écrits au cours de la guerre et jusqu’à la révolution d’octobre, ne peut être comprise qu’en prenant en considération les conceptions auxquelles elle s’opposait. L’impérialisme est une réfutation directe de Karl Kautsky. Celui-ci a fourni l’argumentation théorique pour les trahisons des dirigeants de la Seconde Internationale qui ont soutenu leur « propre » bourgeoisie nationale dans la guerre impérialiste.
Quand Lénine qualifiait l’impérialisme de stade « suprême » du capitalisme, c’était en réponse à l’assertion de Kautsky selon laquelle le militarisme et la guerre n’étaient pas des tendances objectives du développement capitaliste, mais bien plutôt une phase passagère, et que le conflit féroce qui avait éclaté entre les grandes puissances capitalistes — le déchaînement de la barbarie — pouvait être remplacé par un partage pacifique des ressources planétaires, de façon très similaire à la façon dont les monopoles, résultant de la libre concurrence, formaient des cartels pour se répartir les marchés.
L’analyse de la Première Guerre mondiale faite par Lénine, Trotsky, Luxembourg et d’autres marxistes montrait non seulement que la guerre était le résultat des contradictions croissantes du capitalisme, mais elle expliquait encore que le déclenchement de la guerre était lui-même une expression violente du fait que l’époque progressiste du développement capitaliste était révolue. Désormais, selon la formule de Rosa Luxembourg, l’humanité faisait face aux alternatives historiques du socialisme ou de la barbarie. C’est pourquoi le socialisme devenait une nécessité historique objective pour la continuation du progrès humain. La lutte pour le pouvoir politique par la classe ouvrière n’était pas une perspective pour un avenir indéfini, mais se trouvait placée à l’ordre du jour.
Kautsky cherchait à construire son opposition à cette perspective sur une base marxiste. Le système capitaliste maintenait-il, n’avait pas épuisé ses ressources, la guerre ne représentait pas son agonie mortelle et la classe ouvrière, ayant été impuissante à arrêter la guerre, n’était pas dans une position qui lui permettait de lancer une lutte pour le renversement de la bourgeoisie.
Pourtant, près de 30 ans auparavant, Friedrich Engels avait présenté une perspective entièrement différente, fondée sur la compréhension qu’une époque entière s’était terminée et que les guerres futures seraient très différentes de celles du dix-neuvième siècle.
« Aucune guerre n’est désormais possible pour l’Allemagne prussienne, » écrivait-il, « si ce n’est une guerre mondiale et une guerre mondiale d’une étendue et d’une violence jusqu’ici vraiment inimaginable où huit à dix millions de soldats s’entretueront et ce faisant engloutiront toute l’Europe et la mettront plus à nue que des nuées d’insectes n’ont jamais pu le faire. Les dévastations de la Guerre de Trente Ans ramassées en trois ou quatre ans et répandues sur la totalité du continent ; la famine, les épidémies, l’effondrement moral général tant des armées que de la masse des populations résultant d’une détresse aiguë, un dérèglement sans espoir des mécanismes artificiels du commerce, de l’industrie et du crédit finissant en une banqueroute généralisée ; l’effondrement des vieux Etats et de leur réputation de sagesse avisée à un tel point que les couronnes rouleront par douzaines sur le pavé et qu’il ne se trouvera personne pour les ramasser ; l’impossibilité absolue de prévoir comment tout cela se terminera et qui sortira victorieux de l’affrontement ; un seul un résultat étant assuré : l’épuisement général et l’établissement des conditions préalables pour la victoire définitive de la classe ouvrière. » [43]
En défendant la décision du SPD de voter les crédits de guerre, Kautsky s’appuyait sur le soutien initial donné par une partie des masses en faveur de la guerre. Il n’était pas possible de s’opposer à la guerre et encore moins de se battre pour le renversement de la bourgeoisie dans de telles conditions. Par-dessus tout, soutenait-il, il ne devait pas y avoir d’affrontement dans le parti à l’encontre des partisans les plus droitiers du gouvernement et de la guerre. « Dans la guerre », écrivait-il, « la discipline est la première prescription non seulement dans l’armée mais aussi dans le parti. » La tâche la plus importante de l’heure était de « préserver l’intégrité de l’organisation et des organes du parti et des syndicats. » [44]
L’alternative entre impérialisme et socialisme était, une grossière et excessive simplification d’une situation complexe disait Kautsky. Il était nécessaire de maintenir le parti et ses organisations et de se préparer pour un retour à des conditions pacifiques où le parti reprendrait son cours d’avant-guerre.
Dans sa lutte contre Kautsky, Lénine montra qu’il était nécessaire d’affronter l’objectivisme et le fatalisme complet qui avait fini par dominer la Deuxième Internationale. Entre les mains de Kautsky, le marxisme s’était transformé d’un guide de l’action révolutionnaire en une rationalisation sophistiquée du fait accompli.
Il n'était pas possible, insistait Lénine, de faire une évaluation de la situation objective sans inclure dans cette appréciation le rôle du parti lui-même. Il était vrai que les masses ne s'étaient pas opposées à la guerre, mais ce « fait » ne pouvait pas être pris en compte indépendamment du rôle du parti, et par-dessus tout de sa direction. En garantissant sa loyauté au régime des Hohenzollern [la famille royale de Prusse, ndt], le SPD avait lui-même contribué à cette situation. Non pas que Lénine ait soutenu que la tâche du parti ait été de lancer une lutte immédiate pour la prise du pouvoir — c'était une caricature invoquée par les opportunistes. Il était néanmoins nécessaire de maintenir une opposition intransigeante à l'égard du gouvernement pour préparer les conditions où les masses elles-mêmes se retourneraient contre lui.
Selon les opportunistes, le gouvernement était au sommet de sa force lorsqu'il déclencha la guerre et en conséquence le parti ne pouvait pas s'opposer ouvertement à lui, étant donné qu'une telle action aurait conduit à la destruction du parti. A l'opposé, Lénine maintenait qu’en se lançant dans la guerre, le régime en place avait plus que jamais besoin de l’approbation des partis mêmes qui avaient clamé leur opposition à celle-ci dans le passé.
L’appréciation de Lénine a été vérifiée par le cours de l’histoire. L’attitude du SPD envers le déclenchement de la guerre avait fait l’objet de discussions depuis quelque temps au sein des classes dirigeantes allemandes et des cercles politiques. Il existait des craintes que si la guerre tournait mal, la chute du régime lui-même suivrait rapidement une défaite militaire.
Lors de la crise de juillet, la prise de position du SPD était un élément majeur des calculs de Bethmann-Hollweg [chancelier impérial de 1909 à 1917, ndt]. Sa tactique était déterminée par l’estimation que les dirigeants du SPD soutiendraient la guerre si elle pouvait être présentée, plutôt que comme le déclenchement d’une offensive, ce qu’elle était en réalité, comme la réaction de l’Allemagne à une attaque de la Russie. Une guerre contre le tsarisme pouvait alors recevoir une coloration « progressiste ».
Au cœur du conflit entre Lénine et Kautsky se trouvait leur appréciation opposée du futur du capitalisme comme système social. Pour Lénine, la nécessité d’une révolution socialiste internationale — la révolution russe de 1917 étant alors conçue comme le premier pas dans cette direction — découlait de l’appréciation que l’éruption de la guerre impérialiste représentait l’inauguration d’une crise historique du système capitaliste, laquelle, malgré des trêves et même des accords de paix, ne pourrait être surmontée.
De plus, le processus économique même qui se trouvait au cœur de l’époque impérialiste — la transformation du capitalisme concurrentiel du dix-neuvième siècle en un capitalisme monopolistique au vingtième — avait créé les fondations objectives pour le développement d’une économie socialiste internationale.
La perspective de Kautsky était établie dans un article publié au moment où la guerre éclatait, mais qui avait été préparé dans les mois qui l’avait précédé et dans lequel il évoquait la possibilité que la phase impérialiste actuelle allait conduire à une nouvelle époque d’ultra-impérialisme.
L’impérialisme, écrivait-il, est un produit du capitalisme industriel hautement évolué. Il consiste dans la tendance de chaque nation capitaliste industrielle à s'annexer ou à s'assujettir des régions agraires toujours plus grandes. De plus, l’incorporation des zones conquises en tant que colonies ou en tant que sphères d’influence de la nation industrielle en question signifiait que l’impérialisme en avait fini avec le libre commerce comme moyen de l’expansion capitaliste. La conquête impérialiste de régions agricoles et les efforts pour réduire leurs populations en esclavage continueraient, maintenait Kautsky, et ne cesseraient que lorsque les populations des colonies ou le prolétariat des pays capitalistes industrialisés seraient devenus assez forts pour rejeter le joug capitaliste. Ce côté de l’impérialisme ne pouvait être conquis que par le socialisme.
« Mais l’impérialisme a un autre côté » poursuivait Kautsky. La tendance qui tend à l’occupation et à l’assujettissement des zones agraires a produit des contradictions aiguës entre les Etats capitalistes, avec le résultat que la course aux armements qui était auparavant seulement une course aux armements terrestres est également devenue une course navale aux armements, et que la Guerre mondiale prophétisée depuis longtemps est maintenant devenue un fait. Kautsky se demande ensuite si cet aspect du capitalisme est, lui aussi, une nécessité pour la poursuite de l’existence du capitalisme, un aspect qui ne pourra être surmonté qu’avec le capitalisme lui-même.
« Il n’y a pas de nécessité économique à continuer la course aux armements après la Guerre mondiale, même du point de vue de la classe capitaliste elle-même, à l’exception de tout au plus certains intérêts dans l’armement. Au contraire, l’économie capitaliste est sérieusement menacée précisément par les contradictions entre les Etats capitalistes. Tout capitaliste qui voit loin doit en appeler à ses collègues : capitalistes de tous les pays, unissez-vous ! »
Tout comme l’analyse par Marx de la concurrence insistait sur le développement du monopole et sur la formation des cartels, continuait Kautsky, le résultat de la guerre pourrait être une fédération des pays impérialistes les plus puissants pour renoncer à la course aux armements.
« Par conséquent, du point de vue strictement économique, il n’est pas impossible que le capitalisme puisse survivre à travers une nouvelle phase, la transposition de la cartellisation dans le domaine de la politique étrangère, une phase d’ultra-impérialisme, contre laquelle nous devons bien entendu lutter aussi énergétiquement que nous le faisons contre l’impérialisme, mais dont les périls se trouvent dans une autre direction, pas dans celle de la course aux armements et dans la menace de la paix mondiale. » [45]
Selon l’analyse de Kautsky, il n’y avait pas de nécessité historique objective de renverser le capitalisme par le moyen de la révolution socialiste afin de mettre fin à la barbarie libérée par la guerre impérialiste. Au contraire, mis à part quelques sections isolées en rapport avec l’industrie des armes, les impérialistes eux-mêmes avaient intérêt à s’entendre pour garantir un état de paix mondiale dans le cadre duquel ils pourraient continuer leur pillage économique.
Dans sa réponse à Kautsky, Lénine indiqua clairement que, alors que la tendance du développement économique allait bien dans la direction d’un unique trust mondial, cela se déroulait dans de telles contradictions et de tels conflits — économiques, politiques et nationaux — que le capitalisme serait renversé bien avant qu’aucun trust mondial n’ait vu le jour et que la fusion « ultra-impérialiste » de la finance capitaliste ait pu avoir lieu.
En outre, les alliances ultra-impérialistes, qu’elles soient constituées d’une coalition impérialiste contre une autre ou « d'une union générale embrassant toutes les puissances impérialistes, » ne sont « que des “trêves” entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les guerres et, à leur tour, naissent de la guerre ; elles se conditionnent les unes les autres, engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même base, celle des liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique mondiale. » [46]
Il existait des raisons objectives profondes, enracinées dans la nature même du mode de production capitaliste, pour lesquelles il était impossible de maintenir une alliance ultra-impérialiste du type envisagé par Kautsky. Le capitalisme, de par sa nature, se développe inégalement. Après tout, il y a 50 ans l’Allemagne était « un pays misérable et insignifiant », si l’on comparait sa force capitaliste d’alors à celle de l’Angleterre. Et maintenant elle luttait pour conquérir l’hégémonie en Europe.
Il était inconcevable que dans 10 ou 20 ans la force relative des puissances impérialistes ne se soit pas à nouveau modifiée. Par conséquent, toute alliance formée à un moment dans le temps sur la base de la force relative des participants se briserait à un moment dans le futur, donnant lieu à la formation de nouvelles alliances et de nouveaux conflits, à cause du développement inégal de l’économie capitaliste elle-même.
Il y avait un autre aspect majeur de l’analyse de Lénine, pas moins important que sa réfutation de la perspective de Kautsky sur l’ultra-impérialisme. La nécessité objective historique de la révolution socialiste ne résultait pas seulement du fait que l’impérialisme et le capitalisme monopoliste conduisaient inévitablement à des guerres mondiales. Elle était enracinée dans les transformations mêmes des relations économiques qui étaient induites par le capitalisme monopolistique.
« Le socialisme », écrivait Lénine, « nous regarde au travers de toutes les fenêtres du capitalisme. » [47] Il était nécessaire, insistait-il, d'examiner la signification des changements dans les relations de production dus au développement du capitalisme de monopole. Il n'y avait pas qu'un entrelacement de la propriété. Une vaste socialisation mondiale de la production se produisait sur la base du capitalisme de monopole.
« Quand une grosse entreprise devient une entreprise géante et qu'elle organise méthodiquement, en tenant un compte exact d'une foule de renseignements, l'acheminement des deux tiers ou des trois quarts des matières premières de base nécessaires à des dizaines de millions d'hommes; quand elle organise systématiquement le transport de ces matières premières jusqu'aux lieux de production les mieux appropriés, qui se trouvent parfois à des centaines et des milliers de verstes ; quand un centre unique a la haute main sur toutes les phases successives du traitement des matières premières, jusque et y compris la fabrication de toute une série de variétés de produits finis ; quand la répartition de ces produits se fait d'après un plan unique parmi des dizaines et des centaines de millions de consommateurs (...) alors, il devient évident que nous sommes en présence d'une socialisation de la production et non point d'un simple “entrelacement”, et que les rapports relevant de l'économie privée et de la propriété privée forment une enveloppe qui est sans commune mesure avec son contenu, qui doit nécessairement entrer en putréfaction si l'on cherche à en retarder artificiellement l'élimination, qui peut continuer à pourrir pendant un laps de temps relativement long (...) mais qui n'en sera pas moins inéluctablement éliminée. » [48]
Lénine ne prétendait pas qu'il était impossible au capitalisme de continuer. Plutôt, les relations économiques et de propriété continueraient à se putréfier si leur élimination était artificiellement retardée, c'est-à-dire, traduit dans le langage prudent utilisé dans la brochure pour échapper à la censure, si les directions actuelles de la classe ouvrière n'étaient pas remplacées.
Pour Lénine, tout tournait autour de cette question. C'est pourquoi il insistait, plus que tout autre dans le mouvement marxiste international, sur la nécessité d'une rupture complète avec la Deuxième Internationale, non pas seulement avec ceux qui se situaient ouvertement à droite, mais surtout avec les centristes tels que Kautsky qui jouaient le rôle le plus dangereux. La fondation de la Troisième Internationale était une nécessité historique.
Pour Harding cependant, il y a une contradiction fondamentale entre une analyse qui révèle comment des processus objectifs au sein du capitalisme rendent la révolution socialiste à la fois possible et nécessaire, et en même temps l'insistance sur le rôle vital, indispensable du facteur subjectif dans le processus historique.
La présence de Lénine, fait-il remarquer, fut décisive pour la révolution en Russie. Aucune somme de discussion théorique à propos du niveau des forces productives, du niveau de la conscience socialiste ou de la situation internationale ne pouvait décider du problème de savoir si la Russie entreprendrait une révolution socialiste.
« Cela fut en fait décidé par la seule présence “accidentelle” d'un homme ayant la croyance inébranlable qu'une civilisation était en train de s'effondrer et qu'il était impératif qu'une autre prenne naissance. Tout cela pour en venir au simple constat que le marxisme n’a jamais été une “science de la révolution” et que la recherche d’une conduite de référence faisant autorité et tenant compte des limites “objectives” de l’action, en particulier et tout spécialement dans les périodes de traumatismes révolutionnaires, était vouée à l’échec. » [49]
Il ne serait pas réaliste de nier le rôle décisif joué par Lénine dans la révolution russe. Mais qu’il ait été un facteur aussi décisif dans ce contexte tient au fait que sa perspective était enracinée dans une analyse caractérisée par une ample compréhension des processus objectifs et des tendances en cours de développement.
La révolution a souvent été comparée au processus de la naissance et le rôle du parti révolutionnaire à celui de la sage-femme. La naissance du bébé est la conséquence de processus objectifs. Mais il est tout à fait possible que, sans l’intervention opportune de la sage-femme, guidée par la connaissance du processus de la naissance lui-même, le résultat soit tragique.
Les analogies ont bien entendu leurs limites. Mais un examen de l’histoire montrera que l’intervention décisive de la « sage-femme » dans la révolution russe amena le processus de la naissance à une conclusion réussie et que, de plus, l’absence d’une telle intervention dans les bouleversements révolutionnaires en Allemagne et ailleurs dans la période suivant immédiatement la guerre, a eu des conséquences qui se sont révélées désastreuses. Si Lénine eut un rôle décisif dans la révolution russe, alors on peut dire que l’assassinat de Rosa Luxemburg joua un rôle significatif dans l’échec de la révolution allemande au début des années 1920.
La question demeure : y a-t-il quelque chose qui justifie de dire que la perspective proposée par Lénine a été réfutée ? Pas le fait que le capitalisme a continué de croître et qu’il y a eu depuis des développements dans les forces productrices.
La question importante est celle-ci : la croissance du capitalisme depuis la Première Guerre mondiale et la révolution russe a-t-elle permis de surmonter les contradictions à partir desquelles Lénine, Trotsky et les bolcheviks ont construit leur perspective d’une révolution socialiste mondiale ?
La signification du conflit entre Lénine et Kautsky s’étend bien au-delà des circonstances immédiates de la Première Guerre mondiale. Il impliquait le choc de deux perspectives historiques diamétralement opposées. La théorie de Kautsky de l’ultra-impérialisme ne signifiait pas seulement le rejet de la révolution socialiste dans la période de la guerre, mais pour une période indéterminée dans le futur. Cela tient à ce qu’au cœur de son point de vue sur la situation mondiale se trouvait l’idée que, en fin de compte, l’impérialisme bourgeois reconnaîtrait les dangers pour sa domination venus des contradictions existant entre le développement d’un système mondial de production de plus en plus étroitement intégré et un cadre politique fondé sur le système de l’Etat nation. L’impérialisme bourgeois réussirait à prendre les mesures nécessaires pour que ces contradictions soient atténuées.
Aucun marxiste ne niera jamais la possibilité que la bourgeoisie ne prenne des mesures pour tenter de se sauver elle-même. Effectivement, l’économie politique du vingtième siècle, à un certain niveau, pourrait être écrite comme l’histoire des efforts successifs de la bourgeoisie prenant des mesures pour contrecarrer l’effet des contradictions et conflits générés par le mode de production capitaliste et prévenir l’éclatement de la révolution sociale.
Mais l’analyse du processus d’accumulation — le cœur du mode de production capitaliste — révèle qu’il existe objectivement des limites déterminées à la capacité de la classe dirigeante à supprimer ces conflits. Bien que le « capitalisme dans sa totalité » soit une entité réelle et que ses intérêts puissent être représentés jusqu’à un certain point par des politiciens capitalistes clairvoyants, le capital existe sous la forme de nombreux capitaux qui sont en perpétuel conflit les uns avec les autres pour une portion de la plus-value extraite de la classe ouvrière. Dans la mesure où la masse de la plus-value accessible au capital dans sa totalité augmente, les conflits entre ses différentes sections peuvent être contrôlés et régulés. Mais lorsque la situation se retourne, comme elle le fait inévitablement, il devient de plus en plus difficile de mettre en œuvre de telles régulations et il s’ensuit alors une période de conflit inter-impérialiste qui conduit en fin de compte à des conflits armés.
L’histoire confirme ce que révèle l’analyse théorique. A la fin des années 1980, lorsque la structure des relations internationales d’après-guerre commença à se disloquer, un auteur souligna avec perspicacité la pertinence du conflit entre Lénine et Kautsky.
« Alors que la puissance et la capacité de direction de l’Amérique déclinent du fait de l’action du “principe de développement inégal” », écrivait-il, « la confrontation va-t-elle augmenter et le système va-t-il s’effondrer, étant donné qu’une nation après l’autre poursuit des politiques protectionnistes, ainsi que Lénine l’aurait supposé ? Où les vues de Kautsky seront-elles confirmées, selon lesquelles les capitalistes sont trop rationnels pour permettre ce type de lutte intestine de se développer ? » [50]
Cette question a reçu une réponse dans la période de près de deux décennies écoulée depuis que ces lignes ont été écrites. L’Alliance Atlantique d’après-guerre s’est presque effondrée du fait du rôle toujours plus agressif de l’impérialisme US. Alors que les USA cherchaient à unir l’Europe à la suite de la guerre, ils cherchent maintenant à monter les puissances européennes les unes contre les autres pour défendre leurs intérêts. Les puissances européennes, ayant établi le Marché Commun et l’Union européenne de façon à prévenir le retour des conflits qui amenèrent deux guerres mondiales en l’espace de trois décennies, sont plus profondément divisées qu’à aucun autre moment depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Un conflit mondial a éclaté sur les marchés et les matières premières, en particulier le pétrole. Et à l’Est, la montée en puissance de la Chine est accueillie avec la question de savoir si l’émergence de cette nouvelle puissance industrielle jouera le même rôle déstabilisateur au XXIe siècle que celui joué par l’émergence de l’Allemagne au XIXe et au XXe siècle.
Les mécanismes qui furent mis en place dans la période d’après-guerre pour réguler les conflits entre les grandes puissances capitalistes se sont soit effondrés soit ils sont dans un état de déclin avancé. Les contradictions du mode de production capitaliste qui aboutirent à la Première Guerre mondiale n’ont pas été surmontées, mais au contraire s’accumulent avec une force renouvelée.
Notes:
[1] War and the International (Colombo: Young Socialist Publications, 1971), p vii.
Traduit de l’anglais [N.D.T.: La traduction française disponible sur : http://www.marxists.org/francais/index.htm étant approximative, nous avons préféré retraduire depuis l’anglais, plus proche de l’original allemand]
[2] Traduit de l’anglais Ibid, p. vii.
[3] Traduit de l’anglais Ibid, p. vii.
[4] Traduit de l’anglais Ibid, p. viii.
[5] Traduit de l’anglais “Imperialism and the National Idea,” in Lenin’s Struggle for a Revolutionary International (New York: Pathfinder Press), pp. 369-370.
[6] Traduit de l’anglais War and the International, pp. vii-x.
[7] Traduit de l’anglais Cited in Hamilton and Herwig, Decisions for War, 1914-17 (Cambridge, 2004), p. 19.
[8] Traduit de l’anglais The Pity of War (Allen Lane, 1998), p. 31.
[9] Traduit de l’anglais Ibid, p. 32.
[10] Traduit de l’anglais Ibid, p. 33.
[11] Traduit de l’anglais Wolfgang J. Mommsen, Imperial Germany 1867-1918: Politics and Society in an Authoritarian State (London: Arnold, 1995), p. 89.
[12] Traduit de l’anglais The First World War (Oxford University Press, 2001), p. 101.
[13] Traduit de l’anglais Leon Trotsky, War and the International (Colombo: Young Socialist Publications, 1971), p 6.
[14] Traduit de l’anglais Ibid, p. 13.
[15] Traduit de l’anglais Cited in Eric Hobsbawm, The Age of Empire, p. 302.
[16] Traduit de l’anglais Fritz Fischer, War of Illusions: German Policies from 1911 to 1914 (London: Chatto & Windus, 1975), p. 32.
[17] Traduit de l’anglais Cited in V. R. Berghahn, Germany and the Approach of War in 1914 (Macmillan, 1973), p. 146.
[18] Traduit de l’anglais Ibid, p. 164.
[19] Traduit de l’anglais Cited in Fritz Fischer, World Power or Decline (London: Weidenfeld and Nicholson, 1965), p 14.
[20] Traduit de l’anglais Cited in Fritz Fischer, War of Illusions: German Policies from 1911 to 1914 (London: Chatto & Windus, 1975), p. 449.
[21] Traduit de l’anglais Cited in Fritz Fischer, Germany’s Aims in the First World War (New York: W. W. Norton, 1967), pp. 103-104.
[22] Traduit de l’anglais The Origins of the First World War (Longmans, 1992), p. 169.
[23] Traduit de l’anglais Fritz Fischer, World Power or Decline, p. 18.
[24] Traduit de l’anglais “The World Crisis of 1914-18” in Era of Tyrannies (New York: Anchor Books, 1965), p. 210.
[25] Traduit de l’anglais Cited in Rosa Luxemburg Speaks (New York: Pathfinder Press, 1970), pp. 279-280.
[26] Traduit de l’anglais David Stevenson, Armaments and the Coming of War (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 391.
[27] Traduit de l’anglais Cited in Zara S. Steiner, Britain and the Origins of the First World War (London: Macmillan, 1977), p. 44.
[28] Traduit de l’anglais Ibid, p. 40.
[29] Traduit de l’anglais Cited in Kennedy, The Rise of the Anglo-German Antagonism (London: The Ashfield Press, 1987), p. 467.
[30] Traduit de l’anglais Cited in Berghahn, op cit, pp. 95-96.
[31] Traduit de l’anglais Hamilton and Herwig, Decisions for War, 1914-1917 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p.133.
[32] Traduit de l’anglais Cain and Hopkins, British Imperialism (London: 2002), pp. 195-196.
[33] Traduit de l’anglais John H. Morrow Jr., The Great War: An Imperial History (London: Routledge, 2004), p. 9.
[34] Traduit de l’anglais : See S. B. Saul, Studies in British Overseas Trade, cited in Hobsbawm, Industry and Empire (1968), p. 123.
[35] Traduit de l’anglais : Joll, op cit, p. 146.
[36] Traduit de l’anglais : Leon Trotsky, “On the Question of Tendencies in the Development of the World Economy,” in The Ideas of Leon Trotsky, H. Tickten and M. Cox ed. (London: Porcupine Press, 1995), pp. 355-70.
[37] Traduit de l’anglais : Trotsky, The First Five Years of the Communist International, vol. II, p. 306.
[38] Traduit de l’anglais : Neil Harding, Leninism, p. 11.
[39] Traduit de l’anglais : Ibid, p. 113.
[40] Traduit de l’anglais : Ibid, p. 114.
[41] Traduit de l’anglais : Ibid, pp. 277-78.
[42] Lenin, Collected Works, Volume 22, p. 300.
Traduction française reprise de L’Impérialisme stade suprême du capitalisme :
[43] Traduit de l’anglais : Cited in Lenin, “Prophetic Words,” in Collected Works Volume 27, p. 494.
[44] Traduit de l’anglais : Cited in Massimo Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist Revolution 1880-1938 (London: Verso, 1990), p. 184.
[45] Kautsky, Ultra-imperialism in New Left Review, no. 59, January-February, 1970.
[46] Lenin, Collected Works, Volume 22, p. 295.
Traduction française reprise de L’Impérialisme stade suprême du capitalisme :http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp9.htm
[47] Traduit de l’anglais : Lenin, Collected Works, Volume 25, p. 363.
[48] Lenin, Imperialism, op cit, p. 303.
Traduction française reprise de L’Impérialisme stade suprême du capitalisme :http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp10.htm
[49] Traduit de l’anglais : Neil Harding, Leninism, p. 110.
[50] Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton University Press, 1987), p. 64.