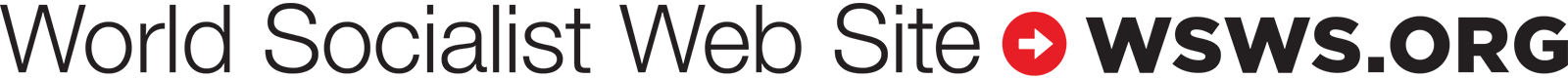1. Une immense expérience stratégique de la classe ouvrière
L’élection de septembre 2015 en Grèce qui a reconduit au pouvoir Syriza (la « Coalition de la gauche radicale) menée par le premier ministre Alexis Tsipras achève un stade déterminé de ce qui s’est avéré être une immense expérience stratégique de la classe ouvrière.
Catapultée à la tête du gouvernement en janvier, Syriza a promis de mettre fin aux mesures d'austérité de l'Union européenne (UE). Les attaques sociales dévastatrices de l'UE avaient fait de la Grèce le centre de l'assaut mondial sur les acquis sociaux des travailleurs en cours depuis le krach de 2008; des millions de travailleurs et de jeunes autour du monde suivaient avec attention les luttes de la classe ouvrière grecque. Les reportages dans les médias, les critiques de Syriza par des politiciens européens réactionnaires, et les déclarations mêmes de Syriza portaient les masses à croire que Tsipras et son ministre des Finances, Yanis Varoufakis, étaient des radicaux prêts à défier le capitalisme grec et international.
D'innombrables partis qui affichent des positions «anticapitalistes» ou de «gauche», en Grèce et à travers le monde, ont salué l'arrivée au pouvoir de Syriza comme un triomphe de la gauche et un modèle de la lutte contre l'austérité en Europe et à l'échelle internationale.
Dans les huit mois suivants, toutefois, Syriza a totalement renié ses promesses électorales. En février, quelques semaines à peine après son entrée en fonction, elle a signé un accord pour prolonger les mesures d'austérité de l'UE. Elle a ensuite foulé aux pieds le «non» au référendum sur l'austérité qu'elle a organisé en juillet, en faisant adopter de force un nouveau plan d'austérité au parlement.
Cette répudiation flagrante du vote populaire a choqué et assommé les masses. Réélu de justesse en septembre contre la Nouvelle démocratie (ND), de droite, Tsipras s'était présenté comme le candidat préféré de l'UE et des banques, suscitant une abstention massive. Au début de son second mandat, Syriza intensifie des mesures d'austérité qui ont déjà condamné des millions de personnes au chômage, à la pauvreté et à la faim.
Des masses de gens se trouvent confrontés à la traîtrise de partis politiques qui dominaient les mouvements sociaux et à la faillite de ce qui passait pour une politique de gauche pendant toute une période historique. Adeptes des théories d'universitaires postmodernes tels qu'Ernesto Laclau, ces organisations qualifiaient notre époque de «post-marxiste». Issues de couches aisées des classes moyennes, elles soutenaient que la classe ouvrière n'était plus une force révolutionnaire, ayant cédé le pas à une multitude de forces sociales définies par des identités nationales, de genre, ou culturelles.
Pendant des décennies, ces partis donnaient une teinte radicale ou anticapitaliste à leur politique, qui ne l'était pas du tout. Leur première expérience au pouvoir a révélé que cette posture était une fraude qui servait de couverture politique à une ligne pro-capitaliste visant à préserver les intérêts des 10 pour cent les plus riches aux dépens des travailleurs.
En voyage aux Etats-Unis après sa réélection, Tsipras a franchement exposé sa stratégie pro-patronale. Répondant à l'ancien président américain Bill Clinton à la Clinton Global Initiative à New York, Tsipras a dit: «Les investisseurs étrangers sont les bienvenus, ils trouveront un gouvernement mandaté pour changer le pays. ... D'ici quelques années, la Grèce sera une destination convoitée par les investisseurs étrangers, c'est mon opinion et mon souhait.»
Comment Tsipras veut-il attirer les capitaux en Grèce? Alors que tous les gouvernements sabrent les salaires et les acquis sociaux, Syriza espère que ses mesures d'austérité lui permettront d'offrir aux investisseurs grecs et internationaux la main-d’œuvre la plus surexploitée, et donc la plus rentable, d'Europe.
Le programme de Tsipras est fondé sur la destruction d'acquis sociaux dont jouissent les travailleurs d'Europe occidentale depuis des générations. Le patronat grec s’est vu exonéré des coûts de la couverture médicale universelle. Syriza attaque les retraites selon un projet, discuté dans les médias, qui imposerait aux travailleurs l'obligation de cotiser pour des retraites complémentaires, éliminant de fait le droit à une retraite payée par l'État. Le salaire minimum grec rabaissé à €683 par mois est aujourd'hui plus proche des salaires en Chine ou dans les pays les plus pauvres d'Europe de l'est, que du salaire minimum de pays plus riches de la zone euro comme la Hollande ou la France.
L'expérience Syriza souligne la nécessité d'une réorientation fondamentale des travailleurs, des jeunes et des intellectuels attachés au socialisme. Face à une crise économique mondiale sans précédent depuis les années 1930 et à un assaut féroce mené par toute la classe capitaliste, la classe ouvrière ne peut se défendre en élisant de nouveaux gouvernements capitalistes de «gauche».
La seule voie vers l'avant, en Grèce et à l'échelle internationale, c'est une politique véritablement révolutionnaire qui mobilise la classe ouvrière dans la lutte. Cela exige un assaut direct contre la classe capitaliste, la confiscation de ses biens, la saisie des grandes banques et forces productives afin de les placer sous le contrôle démocratique des travailleurs, et la création d'États ouvriers à travers l'Europe et partout dans le monde. De telles luttes requièrent la construction de partis marxistes offrant une direction révolutionnaire à la classe ouvrière, dans une lutte sans merci contre des partis comme Syriza.
C'est la signification historique de la lutte du Comité international de la Quatrième Internationale (CIQI) pour défendre la continuité historique du trotskysme contre des partis tels que Syriza, que le CIQI a fini par qualifier de «pseudo-gauche». Seul le CIQI a averti le prolétariat international que Syriza n'était pas un parti de la «gauche radicale», mais un parti pro-capitaliste, hostile aux travailleurs, qui trahirait ses promesses de mettre fin à l'austérité. Les événements ont donné raison aux critiques de Syriza formulées par le CIQI.
Le bilan de Tsipras démontre que la lutte du CIQI contre la pseudo-gauche n'était pas une querelle de chapelles ou une dispute fractionnelle, mais une lutte entre deux tendances de classe diamétralement opposées. Alors que Syriza imposait aux travailleurs le diktat du capital financier et des capitalistes grecs, le CIQI luttait pour élaborer une perspective révolutionnaire pour la classe ouvrière.
2. Les apologistes de la trahison de Syriza
Toute lutte contre l'austérité doit commencer par un rejet du bilan de Tsipras défendu par Syriza et ses alliés. Les mêmes forces qui saluaient, il y a huit mois, l'élection de Tsipras comme une victoire contre l'austérité, cherchent frénétiquement à cacher l'importance de ces événements.
Certains applaudissent toujours Syriza, malgré tout, comme un parti «de gauche radical». Le Parti de gauche en Allemagne a félicité Syriza après sa réélection, déclarant que l'électorat grec avait décidé que «dans une crise, un gouvernement de gauche est meilleur que les vieux partis corrompus».
D'autres soutiennent le point de vue démoralisé que la capitulation de Syriza à l'UE était la seule réponse possible à la crise grecque et ne pouvait, par conséquent, être une trahison. C'est la stratégie de Stathis Kouvelakis, professeur de philosophie au Kings College à Londres et dirigeant de la Plateforme de gauche au sein de Syriza (à présent, Unité populaire). À une réunion du SWP (Socialist Workers Party – Parti ouvrier socialiste) en Grande-Bretagne, il a déclaré:
«Je pense que le mot "trahison" est mal choisi si on veut comprendre ce qui s’est passé. Bien sûr, objectivement on peut dire qu'il y a eu trahison de la volonté générale, que la population sent très légitimement qu'elle a été trahie.
Cependant, l'idée de trahison implique d'habitude qu'à un moment donné, on décide consciemment de renier ses engagements. Ce qui s'est passé en fait, je pense, est que Tsipras croyait honnêtement qu'il obtiendrait une réaction positive s'il poursuivait une stratégie fondée sur une négociation de bonne foi, c'est pour cela qu'il a toujours insisté qu'il n'avait pas d'autre stratégie.»
Quelle défense misérable de Syriza! Kouvelakis substitue la spéculation psychologique à une analyse de classe. Selon lui, malgré les déclarations maintes fois répétées des dirigeants de l'UE qu'ils ne toléreraient aucun allègement de l'austérité, Tsipras croyait vraiment qu'il pourrait les persuader d'y mettre fin en annonçant d’avance qu'il n’avait pas d’autres stratégie que d’accepter tout compromis que lui offrirait l'UE.
Cette explication n'explique rien. D'abord, Tsipras avait 20 ans d'expérience politique quand il est arrivé au pouvoir; il était constamment en contact avec des chefs d'État et des dirigeants financiers à travers le monde. Il n'est pas crédible d'affirmer qu’il était le naïf politique que Kouvelakis veut faire de lui. Cependant, même si l'on supposait que Tsipras était l'homme le plus naïf au monde, Kouvelakis n'explique pas pourquoi, une fois que l'UE a insisté sur l'austérité comme on pouvait s’y attendre, Tsipras n'a pas élaboré une alternative à la capitulation totale.
Il n'est pas difficile de comprendre les impératifs de classe qui lui ont dicté ce choix. Il a agi afin de défendre les intérêts des 10 pour cent de Grecs les plus riches, qui voulaient préserver l'euro, les banques et l'alliance de la Grèce avec l'UE et l'OTAN. Toute tentative de mobiliser l'opposition de masse à l'austérité dans des grèves ou des manifestations aurait fait obstacle à la politique pro-patronale qu'il a ouvertement préconisée après les élections de septembre.
Les intentions de Tsipras en arrivant au pouvoir en janvier sont, en dernière analyse, sans importance. Ses grandes décisions – de signer le protocole d'austérité en février, de rejeter le «non» au référendum de juillet en signant un nouveau mémorandum, et d'imposer un budget d'austérité en octobre – ont démontré une volonté sans faille d'imposer le diktat de l'UE en matière d’austérité. Ces actions constituent une trahison flagrante des promesses électorales de Syriza d'en finir avec l'austérité.
La tentative maladroite de Kouvelakis de laver Tsipras de toute responsabilité est indissociable de son projet plus large: bloquer le développement d'une alternative qui déborderait Syriza sur sa gauche.
À la même réunion du SWP, Kouvelakis a dit: «Je veux ajouter une réflexion plus générale sur ce que l'on entend par avoir raison ou être vaincu dans une lutte politique. Je pense que, pour un marxiste, il faut une compréhension historicisée de ces termes. On peut dire, d'un côté, que l'on a eu raison parce que notre prédiction s'est avérée vraie. C'est la vieille stratégie du ‘je vous l'avais bien dit’. Mais si on ne peut pas donner un pouvoir concret à cette position, politiquement on est battu».
Ce message est profondément cynique. Aux opposants de Syriza sur sa gauche, il dit: «Malgré vos critiques de Syriza, vous n'avez pas pu nous empêcher de mener à bien notre trahison. Nous, qui étions au pouvoir, avons mené une politique réactionnaire. Mais vous, qui nous avez critiqués, ne pouvez rien faire sauf dire, ‘Je vous l'avais bien dit’».
Mais l'expérience de la trahison de Syriza aura des conséquences politiques, même si les apologistes de Syriza tels que Kouvelakis tentent de le nier. La classe ouvrière a reçu une leçon douloureuse et inoubliable sur le caractère de classe de la pseudo-gauche.
Le Comité International de la Quatrième Internationale n'hésite pas à déclarer qu'il a compris la situation politique et a dit la vérité aux travailleurs. C'est ainsi qu'une tendance prolétarienne révolutionnaire établit son autorité dans la classe ouvrière et se prépare à la diriger dans une révolution socialiste. C'est par ce processus, et aucun autre, que les travailleurs règleront «concrètement» leurs comptes avec des gouvernements réactionnaires tels que Syriza.
3. Comment le Comité international a averti la classe ouvrière du danger posé par Syriza
La publication Internet du CIQI, le World Socialist Web Site, a analysé en détails la crise grecque qui a explosé en 2009, après l'élection de Georges Papandréou du parti social-démocrate Pasok. Dès le départ, le WSWS a indiqué que les travailleurs ne pouvaient faire confiance à Syriza, au Parti communiste grec (KKE), à Antarsya, ou à d'autres formations semblables orientées vers le Pasok et les appareils syndicaux grecs, dominés par le Pasok.
En mai 2010, alors que le Pasok adoptait le premier plan d'austérité grec, le WSWS écrivait: «Une stratégie politique indépendante de la classe ouvrière signifie un conflit immédiat avec les syndicats et les organisations des classes moyennes qui tentent de démobiliser l'opposition. En Grèce, les syndicats et leurs alliés, dont le Parti communiste grec et Syriza, feront tout pour maintenir leur alliance avec Papandréou et leur position au sein de l'establishment politique. ... En avançant la perspective qu'il est possible d'influencer le parti social-démocrate de Papandréou, le Pasok, ces forces, comme leurs homologues dans d'autres pays, tentent consciemment de subordonner les travailleurs à l'État, à une politique nationaliste, et au programme d'austérité des banques».
Le Pasok a ensuite lancé l'offensive sociale la plus dévastatrice contre la classe ouvrière en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale – d'abord sous Papandréou, ensuite avec un gouvernement «technocrate» imposé par l'UE qui comprenait ND et le Laos, d'extrême-droite. Le niveau de vie s’est effondré, condamnant des millions de gens à la pauvreté. Ceci a politiquement brisé le Pasok qui, avec ND, avait été le principal parti de gouvernement de la bourgeoisie grecque depuis la chute en 1974 de la junte des colonels soutenue par la CIA.
Quand le Pasok s'est effondré aux élections de mai 2012 et que Syriza est arrivée juste derrière ND, le WSWS a souligné le caractère réactionnaire de son programme: «Le "pacte de croissance" discuté actuellement avec l'UE, sur lequel Tsipras fonde clairement ses espoirs, donnerait plus de fonds aux banques en faillite et aux "réformes structurelles" pour doper la compétitivité, bref, pour faire monter la flexibilité et baisser les salaires. Les coupes budgétaires continueraient sans arrêt. Si Syriza gagnait l'élection grecque, elle jouerait un rôle important pour imposer de telles attaques».
Après la victoire de ND aux élections de 2012, les principaux gouvernements impérialistes ont commencé à faire l'éducation de Tsipras, qui a fait le tour des capitales européennes et puis, en 2013, est allé à Washington et à New York. Examinant la promotion de Syriza par les puissances impérialistes, les médias et la pseudo-gauche, le WSWS a conclu: «Dans les luttes à venir, les travailleurs confronteront en Syriza un ennemi. Son but, au pouvoir ou dans l'opposition, est de canaliser l'opposition populaire à l'austérité et de maintenir la domination politique du capital financier sur la classe ouvrière».
Quand Syriza est arrivée au pouvoir en janvier 2015, après une année de grèves et de manifestations contre l'austérité imposée par ND, le WSWS a commenté: «Pour les travailleurs, un gouvernement Syriza ne serait pas une sortie de crise mais, au contraire, un immense danger. Malgré sa façade de gauche, Syriza est un parti bourgeois recruté parmi les couches aisées des classes moyennes. Les bureaucrates syndicaux, universitaires, cadres et parlementaires qui dictent sa politique veulent défendre leurs privilèges en préservant l'ordre social. Si son dirigeant Alexis Tsipras promet un (tout petit) allègement de l'austérité terrible en Grèce, il ne se lasse jamais de promettre aux représentants des banques et des États qu'ils n'ont "rien à craindre" d'un gouvernement Syriza.»
Le bilan du gouvernement Syriza a confirmé ces avertissements. Dès le départ, Syriza craignait et déplorait les aspirations de millions de personnes qui avaient voté pour elle. Au lieu d'appeler à des manifestations internationales et d'autres formes d'opposition de masse à l'austérité en Europe, Syriza a lancé une offensive de charme auprès des classes dirigeantes européennes. Sa perspective était d'obtenir un relâchement marginal de l'austérité, par une renégociation limitée de la dette et d'autres concessions obtenues en faisant appel à la générosité des banquiers européens.
Le premier ministre des Finances de Tsipras, Yanis Varoufakis, a plus tard dit à l'Observer que dans ses premières négociations avec l'UE, il a proposé des mesures économiques «courantes à la Thatcher ou à la Reagan», co-écrites avec un «Bureau international de conseillers» qui comprenait Lord Norman Lamont, ministre des Finances du gouvernement conservateur britannique de John Major, et l'ancien secrétaire américain au Trésor, Lawrence Summers.
Les dirigeants de Syriza se sont abaissés devant l'UE, encourageant ainsi Berlin, les banques, et les autres puissances européennes à durcir leurs menaces contre la Grèce. En visite à Berlin le 11 février, Varoufakis a dit que la chancelière allemande «Angela Merkel est de loin la personnalité politique la plus habile d'Europe. C'est incontestable. Et Wolfgang Schäuble, son ministre des Finances, est peut-être le seul homme politique européen ayant de la substance intellectuelle».
Syriza n'a pris aucune mesure pour protéger la classe ouvrière des exactions de la bourgeoisie grecque, dont les intérêts étaient l'enjeu principal de ses pourparlers avec les créanciers de la Grèce. Elle a accordé à l'élite financière grecque une liberté totale pour piller l'économie et faire sortir des milliards d'euros du pays dans les mois ayant suivi son élection. Elle n'a pas imposé de contrôle pour bloquer cette fuite de capitaux, encore moins nationalisé les banques ou pris une quelconque mesure qui aurait nui à la richesse, au pouvoir ou aux privilèges de la classe dirigeante grecque.
Quand Syriza a jugé que l'enthousiasme et les attentes populaires étaient suffisamment retombés, et la situation politique quelque peu stabilisée, elle a rapidement capitulé devant l'UE. Le 20 février, elle a accepté de prolonger le mémorandum d'austérité et de proposer de nouvelles mesures d'austérité, abandonnant les timides réformes de son Programme de Thessaloniki, sur lequel elle avait fait campagne. Quatre jours plus tard, elle a promis de couper les dépenses de santé, d’éducation, de transports et d'autres services essentiels. Après cela, malgré les manœuvres de Tsipras, le caractère de classe réactionnaire de Syriza ne pouvait plus faire de doute.
Au printemps, alors que l'UE refusait de faire la moindre concession, même symbolique, Tsipras chercha désespérément le moyen de justifier devant le peuple grec les mesures d'austérité qu'il avait acceptées.
Le 30 avril, quand Tsipras a d'abord lancé l’idée de proposer un référendum sur l'austérité, le WSWS a averti: «Afin de parvenir à un accord avec l'UE, Syriza se prépare à imposer de profondes coupes sociales qui trahissent ouvertement ses engagements de campagne de mettre fin à l'austérité. Tsipras a donc indiqué que Syriza pourrait organiser un référendum pour donner un semblant de légitimité démocratique à des politiques dictées par l'UE et que le peuple grec rejette à une majorité écrasante».
Finalement, en juin, Tsipras a annoncé un référendum sur l'austérité prévu pour le 5 juillet et il a appelé à voter «non». Même les défenseurs de Tsipras avouent à présent que c'était une fraude cynique, comme l'avait averti le WSWS. Tsipras comptait perdre le référendum et utiliser le «oui» comme prétexte pour démissionner, permettant à la droite de revenir au pouvoir et d'imposer l'austérité.
Un admirateur de Syriza, le pabliste de longue date Tariq Ali, a écrit dans la London Review of Books: «Ce n'est plus un secret que Tsipras et sa garde rapprochée misaient sur un "oui" ou un "non" serré. ... Pourquoi Tsipras a-t-il organisé un référendum? "Il est si dur et idéologique", se plaignait Merkel auprès de ses conseillers. Si seulement. C'était un risque calculé. Il pensait que le camp du "oui" l'emporterait, et il comptait démissionner et permettre aux valets de l'UE de gouverner.»
Ce récit ne fait que confirmer des témoignages antérieurs sur les calculs cyniques qui se cachaient derrière le référendum. Après le référendum et la capitulation de Syriza, Varoufakis, l'ancien ministre des Finances de Syriza, a dit au Guardian: «J'avais supposé, et le premier ministre aussi selon moi, que notre soutien et le "non" s'effondreraient de manière exponentielle».
Un portrait de Varoufakis publié dans le magazine New Yorker décrit l'ancien ministre des Finances à la veille du référendum comme quelqu'un ayant «la sérénité de celui qui est sûr du résultat de l'élection et en savoure déjà les fruits. Son gouvernement, le parti de gauche Syriza, perdrait. Le peuple voterait "oui" – c'est-à-dire pour plus de concessions que Varoufakis et Alexis Tsipras ... avaient dit pouvoir tolérer. Varoufakis démissionnerait de son poste et il n'aurait plus jamais à se taper des réunions qui duraient toute une journée, à Bruxelles et au Luxembourg...»
La seule issue possible du pari référendaire de Tsipras et de la défaite annoncée, expliquait Varoufakis au Guardian, était «le renforcement d'Aube dorée», un parti fasciste grec.
Cependant, les alliés de Syriza ont tous salué le référendum comme une avancée décisive, voire une floraison de la démocratie bourgeoise. Le groupe américain ISO (International Socialist Organization – Organisation socialiste internationale), a publié une déclaration du Réseau rouge, membre de la Plateforme de gauche au sein de Syriza. Selon ses auteurs, la «décision de rejeter l'ultimatum des créanciers, de refuser de signer un nouveau mémorandum d'hyper-austérité, et de laisser s’exprimer la volonté du peuple dans un référendum le 5 juillet est une décision qui transforme la politique grecque».
«Il n'est pas facile de transformer Syriza en parti d'austérité», dirent-ils de manière mémorable.
Le WSWS quant à lui a averti: «Si Tsipras expliquait brièvement aux travailleurs le contenu de son référendum, il dirait: pile l'UE gagne, face vous perdez. Quelques mois à peine après que Syriza a gagné une élection en promettant de mettre fin à cinq ans d'austérité, elle organise un référendum afin de donner une couverture politique à sa capitulation devant l'UE. Si Syriza avait voulu lutter, elle n'aurait pas eu besoin d'organiser un référendum sur l'austérité déjà rejetée par le peuple grec.»
Mais la manœuvre de Tsipras s'est retournée contre lui, et le peuple grec a voté à plus de 61 pour cent contre l'austérité, dans un scrutin fortement polarisé sur des lignes de classe. Les Grecs ont bravé les menaces de l'UE et des médias grecs selon qui l'UE réagirait à un «non» en expulsant la Grèce de la zone euro, décision qui provoquerait une crise financière sans précédent. Ce qui découlait du vote était que la classe ouvrière grecque se préparait clairement à une confrontation avec le capitalisme.
Les dirigeants de Syriza étaient atterrés et terrifiés par la victoire du «non», qu'ils n'avaient soutenu que pour tromper les masses. «Surpris», explique Ali dans la London Review of Books, «ils ont paniqué. À une réunion d'urgence du conseil des ministres, c'était la débandade. Ils ont refusé d'expulser le surveillant de la BCE [Banque centrale européenne] qui contrôlait la Banque de Grèce et rejeté l'idée d'une nationalisation des banques. Au lieu d'accepter le résultat du référendum, Tsipras a capitulé.»
Après deux semaines de pourparlers frénétiques avec les chefs d'État de l'UE, Tsipras a accepté un accord imposant €13 milliards de coupes sociales annuelles, les plus profondes dictées jusqu'ici par l'UE.
Les événements ont confirmé les avertissements du WSWS sur le contenu politique du référendum. Le «non» soulignait la combativité des travailleurs et le caractère illégitime des politiques de Syriza, mais le référendum ne faisait rien pour mobiliser la classe ouvrière dans des luttes de masse. Le référendum avait laissé l'initiative à Tsipras – c'est-à-dire, aux forces de l'austérité.
La classe ouvrière et la vaste majorité des Grecs qui ont voté «non» au référendum de juillet n'avaient aucune représentation aux élections de septembre. Les deux principaux candidats, Tsipras et Maimarakis (de ND), on mené des campagnes ouvertement pro-austérité. Dans un contexte d'abstention de masse, Tsipras s'est fait réélire par défaut, à cause de l'absence d'une alternative à l'austérité, bénéficiant de manière imméritée de la profonde hostilité populaire envers ND.
Depuis sa réélection, Tsipras et Syriza ont dirigé un assaut sauvage sur les acquis sociaux de la classe ouvrière grecque, en collaboration avec l'UE. Son budget d'austérité réduisait la retraite minimum de 20 pour cent, et Syriza tente à présent d'éliminer les protections données aux propriétaires de maisons dont les hypothèques souffrent d'arriérés, ce qui pourrait mettre des centaines de milliers de familles à la rue. Ces attaques barbares sont une confirmation de plus que la classe ouvrière ne peut se défendre que par une lutte déterminée contre Syriza.
4. Les origines et l'évolution de Syriza
La trahison perpétrée par Syriza n’est pas tombée du ciel. Bien que Syriza se donnât pour un parti « de gauche radical», sa politique au pouvoir découlait directement de toute son histoire: c'était, depuis le départ, un parti bourgeois hostile aux travailleurs et au marxisme.
Syriza s'est constituée en 2004, lorsque différents groupes petit-bourgeois ont rejoint Synaspismos («Coalition», ou SYN). À l'époque, Tsipras était un jeune dirigeant de SYN qui était, comme le KKE, un rescapé de l'effondrement du stalinisme grec. Les groupes que SYN attirait à elle, tels que la DEA (Gauche ouvrière internationaliste, un parti anti-trotskyste qui dénonçait l'URSS comme une société «capitaliste d'État»), sortaient du mouvement étudiant qui s'était développé après la chute de la junte des colonels en 1974.
Ce mouvement étudiant s'est formé dans des conditions où le capitalisme avait été discrédité auprès de vastes couches de la société grecque par les crimes du fascisme, de la Guerre civile grecque et de plusieurs dictatures militaires. Les étudiants rejoignaient volontiers les manifestations ou les grèves organisées par des syndicats liés au Pasok, ce qui leur donnait de la publicité et une certaine influence. Mais ceci ne voulait pas dire que ces étudiants étaient acquis à la perspective d'une révolution prolétarienne.
En fait, leur évolution s’est faite en accord avec le large tournant vers la droite effectué au sein de l'intelligentsia petite-bourgeoise au plan international après 1968. Cette année-là, l'armée soviétique a écrasé le soulèvement de Prague et le Parti communiste français a bloqué la prise du pouvoir par les travailleurs après la grève générale de mai-juin 1968. Les partis staliniens se révélaient être des défenseurs de l'ordre établi, alors que de larges couches de travailleurs et de jeunes se radicalisaient. Ils ne pouvaient plus, comme avant, et suivant la politique extérieure contre-révolutionnaire du Kremlin, canaliser la colère sociale et étouffer les luttes révolutionnaires de la classe ouvrière.
Les éléments des classes moyennes représentés au sein du mouvement étudiant n'ont pas réagi au discrédit du stalinisme en essayant de construire de véritables partis révolutionnaires dans la classe ouvrière. Ils ont plutôt utilisé un jargon gauchisant ou pseudo-socialiste afin de justifier leur répudiation de la classe ouvrière en tant que force révolutionnaire, et le rejet de la lutte pour fonder des partis révolutionnaires semblables au parti bolchevik qui, sous la direction de Lénine et Trotsky, avait renversé le capitalisme en Russie en 1917.
Comme le note Panagiotis Sotiris – un dirigeant d'Antarsya, l'une des principales rivales de Syriza dans les milieux petits-bourgeois grecs – ces éléments préféraient bâtir leurs forces dans les classes moyennes. À l'époque, explique-t-il au magazine Jacobin, «nous pensions précisément que des expériences unitaires telles que les regroupements universitaires étaient plus stratégiques. Elles permettraient ce genre de recomposition de la gauche radicale, par opposition à la vieille façon de bâtir une organisation ou un parti».
Pour ses fondations théoriques et politiques, cette forme de politique petite-bourgeoise était redevable d'une couche d'intellectuels postmodernistes ou «postmarxistes» tels que le professeur argentin Ernesto Laclau, qui a formé de nombreux dirigeants de Syriza à l'Université d'Essex au Royaume-Uni. Son livre très lu, Hégémonie et stratégie socialiste, écrit avec l'universitaire belge Chantal Mouffe, lançait une attaque en règle contre la classe ouvrière et le marxisme.
Laclau et Mouffe demandaient à leurs lecteurs «d'abandonner l'idée d'un agent parfaitement uni et homogène, tel que la classe ouvrière du discours classique». Ils rejetaient l'existence de la classe ouvrière et d'une base socioéconomique objective du socialisme et de la révolution socialiste: «La recherche de la "vraie" classe ouvrière et de ses limites est un faux problème qui n'a aucune pertinence théorique ou politique. Évidemment, ceci veut dire ... qu'un intérêt fondamental porté au socialisme ne suit pas logiquement d'une position déterminée au sein du processus économique».
Laclau a développé son hostilité au rôle révolutionnaire de la classe ouvrière en hostilité de plus en plus ouvertement irrationnelle contre toute tentative de comprendre la société capitaliste.
Dénonçant «l'impérialisme de la "raison"» en 1991, dans un essai intitulé «Dieu seul sait», Laclau a écrit: «Pensons simplement au débat pour savoir si la classe ouvrière est toujours l'agent historique principal, ou si ce rôle revient aux nouveaux mouvements sociaux. Je dirais que cette façon de formuler le problème est toujours limitée par l'ancienne approche qu'elle essaie de dépasser, car elle insiste pour dire qu'il faut qu'il y ait un agent privilégié du changement historique, défini par une totalité historique et sociale compréhensible de manière rationnelle. Mais c'est précisément cette dernière affirmation qu'il faut remettre en cause.»
C'était ce genre d’idées profondément irrationalistes qui prédominait dans les classes moyennes au moment où SYN se formait en février 1989 au milieu de la crise et de la chute du gouvernement Pasok d'Andreas Papandréou. SYN était le fruit d’une coalition électorale entre le KKE et le Parti de gauche grec. Ce dernier était dominé par les «eurocommunistes», une tendance stalinienne qui avait fait scission avec le KKE, mais comprenait aussi des politiciens bourgeois tels que Nikos Konstantopoulos, qui venait du Pasok.
La critique «eurocommuniste» du stalinisme n'avait rien à voir avec l'opposition marxiste à la bureaucratie soviétique développée par Trotsky et la Quatrième Internationale. Alors que Trotsky luttait pour une révolution politique de la classe ouvrière soviétique pour renverser la bureaucratie parasitaire, rétablir la démocratie ouvrière et défendre les conquêtes sociales essentielles de la révolution d'octobre, l'eurocommunisme était une évolution du stalinisme vers la droite.
Les eurocommunistes reflétaient l'influence croissante des conceptions anti-marxistes exprimées par Laclau à l'intérieur des partis staliniens eux-mêmes. En répudiant explicitement la révolution, le marxisme et la révolution d'octobre, ils voulaient se distancier de Moscou afin de collaborer plus étroitement avec leurs propres classes dirigeantes. Cette tendance, qui prédominait à l'intérieur des Partis communistes italien et espagnol, était un signe avant-coureur de la campagne de la bureaucratie soviétique sous Mikhail Gorbatchev pour restaurer le capitalisme et liquider l'Union soviétique.
La formation de SYN était le prélude à une trahison historique de la classe ouvrière par toutes les variantes du stalinisme grec. Quand le gouvernement Papandréou est tombé et que ND n'a pas obtenu de majorité aux élections qui ont suivi, SYN est entré en coalition avec ND. Les staliniens se sont alliés à la droite grecque, qui avait noyé dans le sang l'opposition des travailleurs lors de la Guerre civile grecque de 1946-1949 et sous la junte des colonels en 1967-1974. Cette coalition s'est ensuite élargie au Pasok, avant qu'elle ne s'effondre en 1990.
Le KKE et les précurseurs de Syriza avaient signalé à la bourgeoisie qu’ils étaient fermement dans le camp de l'ordre capitaliste. Lors de la coalition avec ND, les représentants de SYN occupaient les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Ils avaient ainsi accès aux dossiers officiels sur le meurtre de masse et la torture de travailleurs, de trotskystes et de membres du KKE pendant la Guerre civile qui a suivi la Deuxième guerre mondiale, et sous la junte des colonels. Non seulement SYN n'a pas investigué ces crimes, mais elle a permis la destruction de nombreux dossiers qui auraient permis de poursuivre les responsables en justice.
En 1991, les alliés de SYN dans la bureaucratie soviétique ont dissout l'URSS et restauré le capitalisme, dépouillant la classe ouvrière soviétique et exposant l'ancienne Union soviétique aux interventions impérialistes. Ces crimes monumentaux du stalinisme signifiaient pour le KKE et les précurseurs de Syriza la rupture complète de tout lien qui aurait encore pu les associer aux luttes ouvrières du vingtième siècle. Le KKE a toutefois quitté l'alliance SYN en 1991, faisant de SYN un bastion des anciens «eurocommunistes».
SYN et le KKE venaient d'achever leur transformation: de partis associés à la politique contre-révolutionnaire de la bureaucratie soviétique, ils étaient devenus des partis carrément bourgeois.
Les autres tendances au sein de Syriza (la DEA, des groupes maoïstes et écologistes ainsi que des dissidents du KKE) allaient rejoindre Syriza sur la base de cette évolution pro-capitaliste. Au début des années 2000, comme l'écrit Panos Petrou de la DEA dans un article sur la fondation de Syriza, SYN «était en déclin électoral et risquait de ne pas obtenir suffisamment de votes pour être représentée au parlement. C'était le résultat de sa politique de centre-gauche des années précédentes qui a fait paraître le parti comme une marionnette de Pasok.»
La formation de Syriza en 2004 était une manœuvre qui visait à présenter une image plus à «gauche» et à garder SYN en vie en absorbant d'autres partis qui avaient participé aux manifestations contre la guerre en Irak. Comme l'écrit Petrou, «pour la couche dirigeante de SYN, Syriza était surtout une alliance électorale qui allait lui permettre de dépasser le seuil de 3 pour cent du vote national requis pour entrer au parlement».
Son rôle reflétait la richesse et le conservatisme accrus des couches sociales évoluant au sein de Syriza. Comme l'ont montré les reportages sur les gros comptes en banque et les multiples résidences des ministres de Syriza, les anciens étudiants s'étaient bâti des carrières qui les faisaient entrer dans la classe moyenne privilégiée. Ayant profité de la financiarisation de l'économie européenne, d'un marché de l'immobilier en pleine croissance et de l'introduction de l'euro, leur étude de Laclau et d'autres auteurs du même acabit les avait fermement convaincus des mérites du capitalisme.
Leur état d'esprit se reflétait parfaitement dans les écrits de Laclau et son rejet de la lutte des classes et de la notion même de classe sociale. Dans son livre de 2007, Ideology and Post-Marxism, Laclau écrivait: «Les sujets de la “lutte anticapitaliste” sont multiples et ne peuvent se réduire à une catégorie aussi simple que celle de “classe”. Il y a une pluralité de luttes. Les luttes dans notre société tendent à se multiplier plus nous entrons dans l'époque de la mondialisation, mais elles sont de moins en moins des “luttes de classe”.»
Le rôle du gouvernement Syriza dans l'immense dégradation des conditions de vie des travailleurs grecs démontre les conséquences réactionnaires de ces concepts irrationalistes et anti-marxistes. La position obscurantiste que la réalité ne peut être comprise rationnellement, et le rejet de la classe ouvrière, alimentent théoriquement les partis petits-bourgeois qui n'ont de «gauche» que le nom. Syriza impose ses politiques irrationnelles d'austérité, qui sont l'équivalent d'un suicide économique de la Grèce, sans la moindre pensée pour les masses ouvrières.
5. Les complices «de gauche» de Syriza
Pour que la classe ouvrière puisse engager la lutte contre l'austérité, elle doit d'abord rompre avec cette politique corrompue de la pseudo-gauche. La faillite de cette politique a été démontrée dans le fait que les partis qui se sont présentés en Grèce comme des critiques «de gauche» du premier gouvernement de Tsipras n'ont pas été en mesure de remporter une part substantielle du vote lors des élections de septembre.
Le parti Unité populaire (Laiki Enótita) – qui a accueilli des groupes maoïstes de la coalition Antarsya pour appuyer la Plateforme de gauche après son départ de Syriza – n'a même pas réussi à obtenir les 3 pour cent du vote nécessaires pour faire élire un candidat au parlement.
Une autre coalition regroupant les factions restantes d'Antarsya, y compris divers groupes pablistes et maoïstes, ainsi que l'EEK (Parti révolutionnaire des travailleurs) de Savas Michael-Matsas a obtenu 0,85 pour cent.
Dans le contexte de crise extrême qui sévit en Grèce, ces piètres résultats sont la conséquence du rôle traître joué par ces tendances de janvier à septembre 2015. Si elles n'ont pas gagné d'appui substantiel, c'est parce qu'elles n'ont jamais tenté de se distinguer fondamentalement de Syriza ou de gagner les masses à une perspective révolutionnaire.
La Plateforme de gauche a travaillé avec loyauté au sein du gouvernement Syriza de janvier à juillet, bloquant l'opposition à Syriza qui venait de la gauche. Elle a semé le mensonge que même si Syriza s'était engagée à imposer l'austérité en février, elle pouvait encore mettre en œuvre des mesures de gauche. Dans une résolution adressée à la direction de Syriza, la Plateforme de gauche a affirmé, «malgré la gravité de vos compromis du début, vous pouvez encore sauver la situation en changeant de cap et en adoptant les politiques radicales et socialistes qui sont nécessaires».
Les tentatives de la Plateforme de gauche de se présenter comme un opposant à l'austérité de l'UE ne sont qu'une ruse politique. Fin juillet, la Plateforme de gauche a pris les devants pour empêcher qu'un vote soit tenu au sein du comité central de Syriza sur les mesures d'austérité négociées par Tsipras. Elle a ainsi permis l'adoption de ces mesures d'austérité, tout en évitant de prendre position contre elles.
Quand les timides critiques de la Plateforme de gauche ont commencé à déranger Tsipras dans ses négociations avec l'UE, après que Syriza a signé en juillet le plan d'austérité, Tsipras a dissout son gouvernement et retiré les membres de la Plateforme de gauche de la liste des candidats de Syriza. C'est à ce moment que la Plateforme de gauche a décidé de quitter Syriza pour créer le parti Unité populaire et continuer à semer des illusions sur Syriza et empêcher le développement d'une lutte politique indépendante de la classe ouvrière contre le gouvernement Tsipras.
Panagiotis Lafazanis, le chef de la Plateforme de gauche qui était le ministre de l'Énergie de Tsipras, a déclaré: «Unité populaire veut poursuivre les meilleures traditions du programme de Syriza. Nous voulons nous en tenir à des engagements plus radicaux.»
Sans surprise, l'appel de Lafazanis à défendre le bilan réactionnaire de Syriza a convaincu plusieurs factions d'Antarsya qu'il était maintenant temps de former une alliance directe avec la Plateforme de gauche au sein d'Unité populaire.
En ce qui concerne Michael-Matsas et l'EEK, ils ont jugé qu'un «regroupement» avec d'autres factions d'Antarsya était opportun et ont ainsi créé une autre façade de gauche pour Syriza et la classe dirigeante grecque.
Ces tendances ne s'orientaient pas vers la classe ouvrière, mais vers Syriza. En fin de compte, les travailleurs ont vu, avec raison, qu'elles n'étaient qu'un élément du même mécanisme politique qui les avait trahis.
Il suffit de comparer l'activité de ces organisations dans les huit mois entre janvier et septembre à la façon dont Lénine et le Parti bolchevik ont profité des huit mois séparant l'arrivée au pouvoir du gouvernement provisoire en février 1917 de la révolution d'Octobre. Les bolcheviks ont combattu sans relâche les illusions que les masses entretenaient sur le gouvernement provisoire afin de briser l'emprise des partis bourgeois et de leurs apologistes sur la classe ouvrière. Dans un contexte politique beaucoup plus complexe, ils ont réussi à gagner une influence de plus en plus grande dans la classe ouvrière pour rendre possible la révolution d'Octobre.
Il n'y avait aucune trace d'une telle intransigeance révolutionnaire parmi les forces qui se plaçaient supposément à la gauche de Syriza. Elles ont toutes préparé l'arrivée au pouvoir de Syriza en semant l'illusion qu'un gouvernement Syriza allait mener une lutte contre l'austérité de l'UE. Elles ont ensuite passé les huit mois entre janvier et septembre à s'adapter au gouvernement Syriza, relayant les mensonges quant à la nature de ses politiques et lui laissant le champ libre pour mener à bien sa trahison.
6. Les partis de «la gauche large» et la préparation de nouvelles trahisons
Le gouvernement Syriza n'est pas seulement une expérience amère pour la classe ouvrière grecque. Il a aussi démasqué des partis pseudo de gauche semblables en Europe et dans le monde, qui ont été les alliés et les complices de sa venue au pouvoir et qui ont maintenant une responsabilité politique dans les attaques de Syriza contre la classe ouvrière. Les travailleurs partout dans le monde doivent prendre garde: si la classe dirigeante permet à de tels partis de prendre le pouvoir, ils seront tout aussi réactionnaires que Syriza l'a été en Grèce.
Ces partis sont déjà bien établis en Europe, avec Podemos en Espagne et La Gauche en Allemagne. Comme Syriza, ils sont apparus après la liquidation de l'Union soviétique, lorsque diverses tendances petites-bourgeoises se sont alliées aux éléments staliniens. Ils défendent un programme politique qui combine une rhétorique anti-austérité creuse à une politique pro-impérialiste basée sur les intérêts de sections privilégiées des classes moyennes.
Avant Syriza, le Parti de la Refondation communiste (Partito della Rifondazione Comunista, PRC) en Italie avait offert l'exemple le plus saillant en Europe des conséquences de cette orientation. Refondation communiste provient de la dissolution du Parti communiste italien (PCI) durant la campagne de restauration du capitalisme en Union soviétique et en Europe de l'Est. En plus d'une faction issue du PCI, le parti était constitué de révisionnistes pablistes anti-trotskystes, dirigés par Livio Maitan, et de tendances maoïstes et anarchistes. Depuis 1991, il a fait partie d'une série de gouvernements qui ont mis en œuvre l'austérité en Italie et participé à des guerres impérialistes, de la Yougoslavie à l'Afghanistan.
Rifondazione ayant participé à plusieurs gouvernements réactionnaires, ses défenseurs étaient très conscients qu'ils bâtissaient des partis bourgeois qui allaient mettre en place des politiques réactionnaires et des attaques de la classe ouvrière.
Discutant publiquement du rôle de partis comme Syriza et Rifondazione, qualifiés de partis de la «gauche large», la revue pabliste International Viewpoint a admis que «le rapport avec l'État et la compréhension par le parti de son rôle dans la société» étaient devenus une question urgente. La revue a observé que ces partis «ont à certains moments franchi le Rubicon pour occuper des postes aux plus hauts échelons de l'État ou appuyer explicitement des gouvernements sociaux-libéraux [c'est-à-dire pro-austérité]».
Cette discussion, qui a pris place deux ans avant l'arrivée au pouvoir de Syriza, révèle la mauvaise foi de ses défenseurs de la pseudo-gauche. Tandis qu'ils présentaient Syriza comme un grand pas en avant pour la gauche, ils savaient qu'ils perpétuaient une longue série de trahisons politiques. Cette politique cynique s'appuie sur un mépris grossier et pragmatique de l'histoire.
Selon Alain Krivine, le dirigeant du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) pabliste en France, «le NPA n’a cependant pas à résoudre certains problèmes. Il les laisse ouverts pour les conférences à venir. Par exemple, tous les débats stratégiques sur la prise du pouvoir, les revendications transitoires, la dualité de pouvoirs, etc. Il n’a pas la prétention d’être trotskyste, en tant que tel, mais considère le trotskysme comme l’un des contributeurs, entre autres, au mouvement révolutionnaire. Ne voulant pas, comme nous avons dû le faire sous le stalinisme, arriver à la politique par le rétroviseur, le NPA n’a pas de position sur ce qu’étaient l’Union soviétique, le stalinisme, etc. Sa politique repose sur un accord concernant l’analyse de la période et les tâches.»
Le NPA ne voulait pas parler des expériences historiques clés du vingtième siècle, du mouvement marxiste ou des questions centrales de stratégie révolutionnaire qui sont posées à la classe ouvrière. La politique formulée par le NPA sur cette base ahistorique ne peut être que bornée et réactionnaire, selon les impressions superficielles tirées des reportages des médias ou des conversations de ses dirigeants avec les politiciens au pouvoir.
Comme en attestent les remarques de Krivine, les dirigeants du NPA y voyaient un grand avantage. Cela leur permettait, pendant qu'ils continuaient à se donner un visage «de gauche», de faire des manœuvres tactiques sans principe, comme le fait d'endosser des partis de la «gauche large» tels que Syriza en les qualifiant de grand espoir pour la lutte contre l'austérité, tout en sachant fort bien qu'il s'agissait de partis pro-austérité et pro-guerre.
En Grèce, le NPA s'est associé à toute la fratrie internationale de la pseudo-gauche pour saluer l'arrivée de Syriza au pouvoir comme une victoire. Le NPA a déclaré: «La victoire électorale de Syriza est une excellente nouvelle. Elle remplit d'espoir tous ceux que luttent contre l'austérité en Europe», tandis que La Gauche en Allemagne publiait un communiqué de presse disant que «l'élection en Grèce n'est pas un tournant seulement pour la Grèce, mais pour toute l'Europe. Elle ouvre des possibilités pour un renouvellement de la démocratie et un changement fondamental de direction pour l'Union européenne.»
Un autre exemple est fourni par le parti Xekinima (Start – Organisation socialiste internationaliste), un parti grec affilié à la tendance internationale menée par le Socialist Party (Angleterre et Pays-de-Galles). Après avoir intégré puis quitté Syriza, il a appuyé Syriza à l'élection de janvier 2015.
Dans une interview accordée au Socialist Party avant l'élection, le chef de Xekinima Andros Payiatsos a déclaré que même si tout portait à croire que Syriza «faisait son possible pour en arriver à une entente avec les forces du marché», les masses «devront lutter, et lutteront, pour pousser un gouvernement Syriza à gauche».
La DEA, l'organisation grecque affiliée au groupe américain ISO (International Socialist Organization – Organisation socialiste internationale), était encore plus catégorique. Faisant partie de la Plateforme de gauche au sein de Syriza, elle a écrit: «Dans ces nouvelles circonstances, le rôle de Syriza en tant que parti politique est irremplaçable. Le fonctionnement de son organisation et de ses membres, avec participation collective et démocratie dans tout le parti, n'est pas une option mais un prérequis à la victoire finale de Syriza et à la victoire finale de toute la gauche et de notre peuple.»
Au Brésil, le Parti socialiste des travailleurs unis (PSTU), l'un des principaux partis à sortir de la dissolution du mouvement révisionniste de feu Nahuel Moreno en Amérique latine, a appelé à voter pour Syriza en la qualifiant de «principal outil des travailleurs grecs pour renverser les partis du mémorandum et du pillage» de la Grèce.
Ces tendances ont beau avoir critiqué le programme pro-capitaliste de Syriza, c’était dans l'optique d’amener les travailleurs à se plier à la campagne électorale de Syriza et à voir leurs luttes comme un moyen de pousser Syriza à gauche.
Aucune de ces tendances n'a fait une analyse de classe de Syriza. Tout en saluant la victoire du parti comme le résultat de luttes sociales, elles ont toutes masqué le fait que Syriza était un parti bourgeois qui avait été mis en avant pour étrangler les luttes des travailleurs et imposer les mesures d'austérité que la droite grecque avait été incapable de mettre en œuvre.
Ce n’est pas par erreur, ou à cause d'une faille dans leur analyse théorique, que ces partis ont fait la promotion de Syriza. Ils ont soutenu Syriza et sa politique parce qu’ils représentent, dans leurs divers pays, la même couche privilégiée d’universitaires de «gauche», de bureaucrates syndicaux, de parlementaires et de professionnels qui cherchent à assurer leurs intérêts de classe en appliquant le même genre de politique. Lorsque la classe dirigeante a permis à Syriza de prendre le pouvoir, tous ces partis y ont vu un modèle et espéré qu’on leur donnerait l'occasion de jouer un rôle similaire dans leurs pays respectifs.
Même s'ils ont dû modérer publiquement leur enthousiasme pour Syriza, après qu'elle a imposé un nouveau plan d’austérité de plusieurs milliards d’euros en juillet, ils ont continué à l’appuyer.
Jean-Luc Mélenchon du Front de gauche français a salué Tsipras après qu’il a imposé les mesures draconiennes de l’Union européenne et renié le «non» des Grecs au référendum du 5 juillet. «Nous soutenons Alexis Tsipras et son combat pour permettre la résistance du peuple grec», a déclaré Mélenchon. Le communiqué de presse du Front de gauche déformait également la réalité avec cette affirmation: «Le gouvernement d’Alexis Tsipras a résisté pied à pied comme nul autre ne l’a aujourd’hui fait en Europe. Il accepte donc un armistice dans la guerre qui lui est menée. Nous condamnons cette guerre, ceux qui la mènent et leurs objectifs».
Pablo Iglesias, quant à lui, a fait campagne à maintes reprises aux côtés de Tsipras en tant que secrétaire général de Podemos, le parti espagnol qui espère suivre la même voie vers le pouvoir. Il a justifié les politiques d’austérité de Tsipras sur la base que la seule alternative était «une entente ou une sortie de l’Euro». Il a ajouté: «Les principes d’Alexis sont clairs, mais dans le vrai monde et en politique, il faut également tenir compte du rapport de forces. … Ce que le gouvernement grec a fait est, malheureusement, la seule chose qu’il pouvait faire.»
Encore une fois, un sérieux avertissement est de mise: les partis qui font de telles déclarations à propos du bilan pro-austérité de Syriza cherchent à lui emboîter le pas.
Le fossé politique et de classe qui sépare le CIQI de ces tendances est infranchissable. Alors que le CIQI cherchait à avertir les travailleurs des plans de Syriza, la pseudo-gauche offrait une couverture à ses politiques réactionnaires.
7. Le rôle de l’EEK de Michael-Matsas
Le Comité international a lutté avec tous les moyens dont il disposait pour faire connaître sa perspective et son analyse aux travailleurs grecs, et pour les avertir du rôle que jouerait Syriza. Cependant, le CIQI n’avait pas de section en Grèce.
La responsabilité politique en incombe à Michael-Matsas, le secrétaire général du Parti ouvrier révolutionnaire (EEK). Il dirigeait la seule section du CIQI à avoir soutenu Gerry Healy lors de la scission de 1985 entre le CIQI et le WRP (Workers Revolutionary Party – Parti ouvrier révolutionnaire), alors dirigé par Healy en Grande-Bretagne. Michael-Matsas a rompu avec le CIQI sur une base dénuée de principes, refusant toute discussion avec les autres sections et soutenant que celles-ci n’avaient pas l’autorité nécessaire pour se réunir sans la permission de Healy, qu’il traitait de «leader historique» du CIQI. La source politique de ce comportement était un accord avec l’orientation nationaliste opportuniste de Healy, que partageait Michael-Matsas.
Après sa scission avec le CIQI, Michael-Matsas a proclamé une «Nouvelle ère pour la Quatrième Internationale» qui verrait le trotskysme se libérer du «propagandisme abstrait» et des «pratiques de la défaite et de l’isolement du trotskysme». En pratique, sa «Nouvelle ère» consistait à soutenir Pasok en Grèce et à saluer la Pérestroïka de Michail Gorbatchev comme le début d’une «révolution politique» en Union soviétique. Au cours des décennies suivantes, il a œuvré dans la périphérie de Syriza.
L’EEK a fait une promotion enthousiaste de Syriza au cours des mois précédant sa victoire électorale. Il prétendait aider la population à pousser Syriza à gauche en forgeant une alliance politique avec elle, un «puissant Front uni de toutes les organisations ouvrières et populaires… comprenant le KKE, Syriza et Antarsya, mais aussi l’EEK, les autres organisations de gauche et les mouvements anarchistes et anti-autoritaires». L’EEK appelait quiconque nourrissait des espoirs en Syriza à «exiger que ses dirigeants rompent avec la bourgeoisie, le personnel politique et tous les opportunistes et valets du grand capital».
Comme tous les groupes politiques gravitant autour de Syriza, l’EEK a laissé de côté un point essentiel: Syriza est un parti bourgeois. Michael-Matsas proposait que la classe ouvrière s’unisse autour d’une série d’organisations qui ont établi de manière définitive qu’elles soutenaient le capitalisme et étaient hostiles à la classe ouvrière et au socialisme.
Exhorter les travailleurs à demander aux dirigeants de Syriza de «rompre avec la bourgeoisie» ne pouvait servir qu’à semer des illusions dans ce parti et à cacher le fait qu’il allait inévitablement se retourner furieusement contre la classe ouvrière. Demander «aux dirigeants» de Syriza, c’est-à-dire des criminels politiques bien nantis comme Tsipras et Varoufakis, de rompre avec «tous les opportunistes et valets du grand capital» revient à leur demander de se renier.
Défendant ses manœuvres politiques en Grèce, Michael-Matsas a accusé le CIQI de «sectarisme» pour avoir démasqué le caractère bourgeois de Syriza et averti les travailleurs de l’inévitable trahison des promesses qu’elle a faites à la classe ouvrière. Écrivant au lendemain de la victoire électorale de Syriza, Michael-Matsas a soutenu que «même si le CIQI pouvait dire certaines choses justes sur la nature bourgeoise des dirigeants de Syriza, il a aussi nié la signification de la victoire de Syriza… Les groupes sectaires ferment les yeux sur les occasions qui se présentent parce qu’ils sont indifférents au mouvement de masse.»
Neuf mois plus tard, il n’est guère difficile de dresser un bilan des «occasions» et du «mouvement de masse» qui ont stimulé l’enthousiasme de Michael-Matsas pour Syriza. Syriza a donné à la bourgeoisie européenne l’occasion de poursuivre sa politique d’austérité et d’arracher des dizaines de milliards d’euros à des millions de travailleurs appauvris.
Quant au «mouvement de masse», Syriza n'a rien construit au sein de la classe ouvrière; elle n’a d'ailleurs même pas essayé. Syriza demeure aujourd’hui la machine électorale d’un groupe de politiciens bourgeois et de leurs partisans. Elle a manipulé et exploité la puissante opposition à l'austérité qui régnait parmi les travailleurs afin de maintenir l'alliance du capitalisme grec avec l'Union européenne et l'OTAN, tout en faisant avancer les carrières et fortunes personnelles des principaux politiciens de Syriza.
Michael-Matsas a accusé le CIQI d'être «sectaire» pour n'avoir pas porté Syriza aux nues, comme l'a fait l'EEK. Le CIQI n'a pas seulement averti que Syriza avait une direction bourgeoise – un point que Michael-Matsas concède, satisfait de lui-même – mais que c'était un parti bourgeois et que les travailleurs devaient s'y opposer pour cette raison.
En fait, le CIQI a défendu l'ABC d'une orientation marxiste: encourager les luttes de la classe ouvrière contre la classe capitaliste. Pour l'EEK, dont la scission avec le CIQI en 1985 a marqué sa rupture définitive avec le marxisme, cela dépassait les bornes.
L'EEK a fait l'éloge de Syriza, parlant en termes vagues mais fervents de la «signification» de sa victoire, qu’il a saluée comme une expérience merveilleuse et instructive par laquelle les travailleurs devaient passer. Pendant que la classe dirigeante tendait aux travailleurs grecs la dragée empoisonnée de Syriza, l'EEK faisait son possible pour discréditer les avertissements du CIQI sur ce qui se préparait. L'EEK a fonctionné comme un complice endurci de Syriza et un instrument réactionnaire du capitalisme grec.
8. Construisons le CIQI!
Il faut dire franchement que l’expérience du gouvernement Syriza a constitué une sérieuse défaite pour la classe ouvrière. La tâche cruciale de l’heure est de tirer les leçons politiques de cette défaite et de réarmer politiquement la classe ouvrière – en Grèce, dans toute l’Union européenne et à l’échelle internationale – pour les luttes qu’elle va mener dans la prochaine période.
Les événements ont démontré que la classe ouvrière ne peut défendre ses intérêts même les plus élémentaires en s’appuyant sur des gouvernements bourgeois – y compris ceux dirigés par des partis qui se réclament de la «gauche radicale» – ou en cherchant à faire pression sur de tels gouvernements pour qu’ils appliquent une politique plus favorable aux travailleurs. Les mesures adoptées par Syriza ont prouvé que les travailleurs n’ont pas d’autre choix que la voie révolutionnaire.
La classe dirigeante est en train de rappeler à la classe ouvrière pourquoi le prolétariat russe fut forcé de renverser le capitalisme en 1917. Sa stratégie consiste à démanteler toutes les concessions sociales accordées à la classe ouvrière des pays capitalistes européens au vingtième siècle en réponse au défi politique et idéologique posé par la Révolution d’octobre et l’existence de l’URSS. Elle vise à ramener les travailleurs des décennies en arrière et à les réduire au niveau de pauvreté de leurs frères et sœurs de classe d’Europe de l’est et d’Asie.
La classe ouvrière n’est pas responsable de la défaite en Grèce. Le prolétariat grec a fait preuve d’une grande détermination et a maintes fois démontré ses instincts révolutionnaires. Il avait le soutien solidaire de masses de travailleurs à travers l’Europe, qui sont eux-mêmes visés par les attaques grandissantes de l’Union européenne et qui ont réagi aux attaques contre les travailleurs grecs avec colère et incrédulité.
Malgré l’oppression et la colère grandissantes de la classe ouvrière, celle-ci n’a toutefois pas réussi à trouver spontanément le moyen d’articuler ses intérêts et de s’élever à la hauteur de ses tâches historiques. Elle n’a pas été en mesure de bâtir, de façon improvisée, une direction politique capable de la mener dans la lutte contre l’offensive sans merci de l’UE et des banques.
L’opposition sociale des travailleurs a plutôt été canalisée derrière Syriza – un parti qui faisait des appels cyniques au vaste mécontentement populaire sur la base de mensonges, tout en se préparant sciemment à violer ses promesses. Syriza a recouru aux services d’une myriade de tendances politiques pour semer l’illusion qu’elle allait résister au diktat du capital financier grec et international. Ces nombreux partis de la pseudo-gauche sont maintenant démasqués comme les instruments réactionnaires du capital financier.
La tâche centrale est de réarmer politiquement la classe ouvrière et de construire une nouvelle direction, une direction révolutionnaire, sur la base d'une critique implacable des partis, des individus et des conceptions politiques responsables de la défaite. C’est la signification du travail mené par le Comité international de la Quatrième Internationale autour des événements grecs.
En Grèce, en Europe et partout dans le monde, la classe ouvrière ne peut se défendre qu’en construisant de nouveaux partis ouvriers qui soient entièrement indépendants de toutes les sections de la classe capitaliste, basés sur un programme internationaliste révolutionnaire, et orientés vers la conquête du pouvoir politique, l’abolition du capitalisme et l’établissement d’une société socialiste mondiale.
Le Comité international de la Quatrième Internationale est la seule organisation politique qui cherche à organiser et à unir la classe ouvrière internationale dans la lutte contre l’exploitation capitaliste, la pauvreté et la guerre. Ses décennies de lutte pour la défense des principes marxistes et trotskystes incarnent une immense expérience politique et une perspective minutieusement élaborée pour armer la classe ouvrière en vue de la nouvelle époque révolutionnaire qui s'ouvre. Les questions politiques et historiques qui ont dominé ses six décennies de lutte pour défendre la continuité du trotskisme sont maintenant devenues des questions d'une brûlante actualité pour les masses.
La tâche stratégique et décisive de l’heure est la construction du CIQI. Nous appelons les travailleurs, les intellectuels et les jeunes politiquement conscients en Grèce et partout dans le monde à lutter pour la perspective élaborée dans cette déclaration et à adhérer au CIQI, le parti mondial de la révolution socialiste.
Le 13 novembre 2015