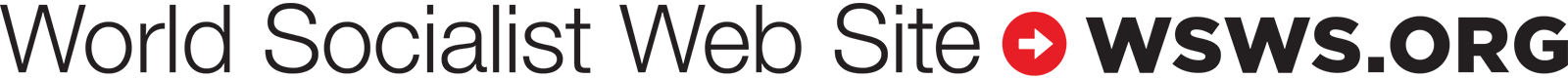Les tensions politiques continuent d’agiter la Géorgie, où le gouvernement a récemment été contraint de retirer une loi qui aurait obligé les organisations et les médias qui reçoivent 20 pour cent ou plus de leur financement de l’étranger à se déclarer «agents étrangers».
Le projet de loi a provoqué des manifestations massives dans la capitale du pays, Tbilissi, où des manifestants qui portaient des drapeaux ukrainiens et de l’Union européenne ont exigé le retrait de la loi. Ils ont dénoncé le gouvernement du Premier ministre géorgien, Irakli Garibashvili, comme étant prorusse parce qu’il imitait le gouvernement de Vladimir Poutine, qui a imposé des lois similaires.
Mardi, Garibashvili a averti que la guerre dans l’Ukraine voisine était sur le point de devenir une conflagration mondiale et s’est interrogé sur la capacité de son gouvernement à «maintenir la paix et la stabilité».
«Aujourd’hui, le monde fait face à la menace d’une troisième guerre mondiale. Cette estimation n’est pas exagérée, ce n’est pas une spéculation. Nous assistons chaque jour à de nouvelles confrontations, tensions et escalades», a déclaré Garibashvili. Sa «principale préoccupation», a-t-il ajouté, est de «sauver le pays».
La Géorgie, une petite nation de 10,8 millions d’habitants située dans le Caucase du Sud, fait depuis longtemps l’objet d’ingérences impérialistes, les États-Unis et l’Union européenne la considérant aujourd’hui comme un élément essentiel pour déstabiliser la Russie. Moscou, qui a mené des guerres brutales dans les années 1990 et 2000 pour réaffirmer le contrôle fédéral sur la région russe de Tchétchénie située juste au nord de la Géorgie, est bien conscient des dangers que représentent pour lui les efforts continus de Washington et de Bruxelles pour placer fermement Tbilissi sous leur domination.
Le gouvernement géorgien actuel, tout en maintenant des liens étroits avec l’OTAN et en cherchant à adhérer à l’UE, a refusé de rompre complètement ses relations avec la Russie après l’invasion de l’Ukraine par cette dernière. Il n’a pas non plus signé l’ensemble des sanctions internationales imposées à son gigantesque voisin du nord et de l’est.
La Géorgie continue d’autoriser les Russes à entrer sur son territoire sans visa. Le gouvernement de Tbilissi a récemment évoqué la possibilité de reprendre les vols directs vers les grandes villes russes. Cette proposition a suscité de vives condamnations de la part de Washington, qui a réussi à fermer presque entièrement la frontière occidentale de la Russie.
Si le caractère profondément antidémocratique de la loi sur les «agents étrangers» que le gouvernement de Garibashvili a cherché à imposer suscite une hostilité généralisée, les manifestations qui ont eu lieu en Géorgie au début du mois de mars n’étaient pas simplement l’expression spontanée d’une indignation populaire, mais un défi politiquement orchestré par le Mouvement national uni (MNU), parti de droite proaméricain, dirigé contre l’approche plus modérée de Tbilissi à l’égard de la Russie.
Le MNU a appelé à une nouvelle manifestation antigouvernementale le 9 avril. Cette date a été choisie avec soin, car elle correspond au 34e anniversaire de l’utilisation de la force par le gouvernement soviétique pour écraser les manifestations indépendantistes en Géorgie. Vingt-et-une personnes sont mortes et des dizaines d’autres avaient été blessées à cette date.
L’aile la plus résolument pro-occidentale de l’élite dirigeante géorgienne tente manifestement d’utiliser la commémoration de cet événement, qui est désormais considéré comme un jour férié national, pour attiser le sentiment antirusse.
Mardi, lors d’une conférence de presse tenue avec son homologue arménien, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé l’Occident d’essayer d’aliéner la Russie de ses voisins et de fomenter une nouvelle «révolution de couleur» en Géorgie avec l’aide d’«organisations non gouvernementales».
En 2003, la «révolution des Roses» a vu l’éviction d’un gouvernement allié à la Russie en Géorgie au profit d’un gouvernement dirigé par Mikheil Saakashvili, qui ne peut être décrit que comme un larbin des États-Unis. Il a lui-même été chassé du pouvoir par la suite en raison de la corruption, de la brutalité et de l’imposition de politiques qui ont conduit à l’appauvrissement de la population.
Alors que les dénonciations par Lavrov de l’ingérence occidentale ne sont pas motivées par la moindre préoccupation pour les droits des citoyens ordinaires en Géorgie, les États-Unis ont effectivement versé des centaines de millions de dollars à diverses «organisations de la société civile» dans le petit pays de la mer Noire.
L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l’une des dizaines d’agences gouvernementales et non gouvernementales qui orchestrent la politique américaine à l’étranger, déclare fièrement sur son site web: «L’USAID a commencé à opérer en Géorgie en 1992. Depuis 27 ans, le peuple américain a fourni plus de 1,8 milliard de dollars d’aide à la Géorgie par l’intermédiaire d’USAID. S’appuyant sur ce partenariat fructueux, le gouvernement américain consacre environ 40 millions de dollars par an à 50 programmes de grande envergure qui soutiennent l’orientation démocratique, de libre marché et occidentale de la Géorgie».
Il est évident qu’USAID n’a pas distribué des tonnes d’argent à divers «partenaires» en Géorgie depuis près de trente ans par magnanimité désintéressée.
Suite au retrait de la loi sur les «agents étrangers» par le gouvernement géorgien le 10 mars, l’UE et les États-Unis ont simultanément cherché à accroître la pression sur Tbilissi et à renforcer les relations avec ce pays. De son côté, le gouvernement géorgien est clairement en train d’essayer, d’une part, d’apaiser les puissances occidentales et, de l’autre, d’éviter de se faire écraser par la campagne de guerre menée par les États-Unis et l’OTAN contre la Russie.
Le 17 mars, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a tenu une conférence de presse avec son homologue géorgien au cours de laquelle il a insisté sur le fait que les relations entre les deux pays étaient vitales pour la sécurité, qu’elles étaient fermes et inébranlables. Dans une allusion évidente à l’influence russe en Géorgie, il a affirmé que la Grande-Bretagne cherchait à renforcer la démocratie géorgienne contre «ceux qui cherchent à la saper».
Quelques jours plus tard, la Géorgie a tenu des réunions avec des représentants de Bruxelles au sujet de la candidature de ce pays du Caucase du Sud à l’adhésion à l’UE, un processus qu’elle a officiellement lancé l’année dernière. L’UE a récemment émis une série de conditions que la Géorgie doit remplir pour être admise. Sous prétexte de «mettre fin à la corruption», de «promouvoir la démocratie» et de «désoligarchiser», toutes ces conditions impliquent d’imposer l’une ou l’autre réforme économique de droite, de placer le système politique et juridique de la Géorgie plus fermement sous le contrôle de Bruxelles ou d’évincer les oligarques alliés à la Russie en Géorgie au profit d’oligarques alliés à l’Union européenne.
Parallèlement à ces négociations, des discussions sont en cours concernant les liens militaires et sécuritaires entre l’UE et la Géorgie, qui se trouve sur une partie de la côte orientale de la mer Noire.
Washington, qui a applaudi les manifestations antigouvernementales en Géorgie au début du mois de mars, joue la carte des «droits de l’homme» pour faire pression sur le gouvernement Garibashvili. Le 20 mars, le département d’État américain a publié un rapport identifiant de «graves problèmes» dans le système judiciaire géorgien et dans son approche de la liberté de la presse.
Le Premier ministre Garibashvili a rejeté ces allégations en les qualifiant de «spéculations, conclusions et rapports fondés sur des informations fausses et fabriquées, fournies par des individus politiquement engagés et partiaux».
Ces dernières semaines, d’autres hommes politiques du parti au pouvoir, le Rêve géorgien, ont évoqué la possibilité de renverser le gouvernement en place. Le 17 mars, Kakha Kaladze, maire de Tbilissi et figure de proue de l’organisation, a accusé l’ancien ministre de l’Intérieur du Mouvement national uni, Vano Merabishvili, et le président du MNU, Levan Khabeishvili, de chercher à organiser «une confrontation, une révolution, un coup d’État».
Le Parti du pouvoir du peuple, composé d’anciens membres du parti Rêve géorgien, a également publié la semaine dernière une déclaration qui décrivait les manifestations de début mars comme étant «dans l’intérêt d’autres pays» et vise à entraîner la Géorgie «sur la voie de la guerre».
(Article paru en anglais le 22 mars 2023)