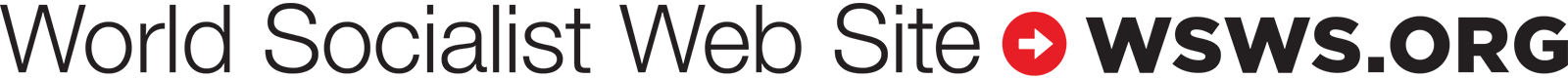L’annonce par le président Donald Trump que les États-Unis entameraient « immédiatement» des négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine a plongé la politique européenne dans une profonde crise.
Avant son entretien téléphonique «long et très productif» avec Poutine mercredi, Trump n’en avait informé ni le gouvernement ukrainien ni les dirigeants européens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a appris la nouvelle qu’après coup, par Trump lui-même. Les Européens ont appris la nouvelle via les réseaux sociaux. Il semble qu’ils ne joueront pas non plus de rôle dans les négociations prévues.
Avant cela, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth avait clairement indiqué lors d’une réunion du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine à Bruxelles qu’il était irréaliste d’espérer que l’Ukraine revienne à ses frontières de 2014 – en récupérant la Crimée et le Donbass – ou qu’elle devienne membre de l’OTAN. Ces deux conditions avaient été jusqu’à présent considérées comme non négociables par Kiev et Bruxelles pour mettre fin à la guerre. Hegseth a également souligné que la garantie d’une paix future était la responsabilité de l’Europe; les États-Unis ne fourniraient à cette fin ni troupes ni soutien financier.
Sous le prédécesseur de Trump, Joe Biden, les États-Unis et l'Europe ont mené conjointement la guerre contre la Russie. Leur objectif était d'intégrer l'Ukraine dans la sphère d'influence de l'OTAN et de l'UE et d'affaiblir stratégiquement la Russie pour s'assurer un accès sans restriction à ses vastes ressources.
Pourtant, malgré une aide militaire et financière de plus de 200 milliards d’euros (209 milliards de dollars) – dont la majeure partie provient de l’Europe –, l’armée ukrainienne reste sur la défensive. Après avoir subi des centaines de milliers de pertes et dû faire face à des désertions croissantes, l’Ukraine peine même à recruter les soldats nécessaires pour la ligne de front.
Les Européens craignent désormais que Trump ne parvienne à un accord avec Poutine à leurs dépens et sans leur participation. De nombreux responsables politiques de haut rang ont protesté contre l'approche unilatérale de Trump.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en garde contre des concessions excessives à la Russie. «Nous devons veiller à ce qu’il n’y ait pas de paix imposée», a-t-il déclaré à Politico, insistant pour dire que les États-Unis devaient poursuivre leur engagement militaire.
Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a déclaré: «Il doit être clair pour tout le monde que nous ne pouvons pas rester assis à la table des enfants.» Il a critiqué l’administration Trump pour avoir révélé publiquement les concessions faites à Poutine avant même le début des négociations. «De mon point de vue, il aurait été préférable de discuter d’une éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ou de pertes territoriales à la table des négociations», a-t-il ajouté. «La paix ne peut être obtenue qu’en position de force.»
Le Premier ministre polonais Donald Tusk a écrit en lettres majuscules sur X que l’Ukraine, l’Europe et les États-Unis devraient travailler ensemble à une «PAIX JUSTE. ENSEMBLE ».
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a souligné qu'il était «important que l'Ukraine soit étroitement impliquée dans tout ce qui concerne l'Ukraine».
Plus tôt cette semaine, le président Zelensky avait déjà tenté de convaincre Trump en lui proposant des incitations économiques. Dans une longue interview au Guardian, il a proposé des opportunités commerciales lucratives en échange d'un soutien militaire américain continu. Il a promis à Trump un accès préférentiel à des minéraux de terres rares d'une valeur de 500 milliards de dollars, ainsi qu'aux importantes réserves d'uranium et de titane de l'Ukraine.
«Il n’est pas dans l’intérêt des États-Unis que ces réserves tombent entre les mains des Russes et soient potentiellement partagées avec la Corée du Nord, la Chine ou l’Iran», a déclaré Zelensky. «Il ne s’agit pas seulement de sécurité, mais aussi d’argent […] Des ressources naturelles précieuses pour lesquelles nous pouvons offrir à nos partenaires des opportunités d’investissement qui n’existaient pas auparavant […] Pour nous, cela créera des emplois et pour les entreprises américaines, cela générera des profits ».
Dans le même temps, Zelensky a clairement fait savoir qu’il ne croyait pas que les puissances européennes étaient capables de remplacer militairement les États-Unis. «Certaines voix disent que l’Europe pourrait fournir des garanties de sécurité sans les Américains, et je dis toujours non», a-t-il déclaré au Guardian. Selon Zelensky, assurer la sécurité de l’Ukraine nécessiterait 100 000 à 150 000 soldats étrangers, un nombre que l’Europe ne peut pas réunir.
Il est actuellement difficile de prédire jusqu'où ira l'initiative de Trump. Il est peu probable que Moscou accepte un accord qui comprendrait le déploiement de troupes européennes ou américaines en Ukraine, l'expansion de l'OTAN vers l'Est ayant été la principale raison du déclenchement de la guerre il y a trois ans.
L’initiative de Trump et les réactions alarmées des Européens marquent néanmoins un tournant politique. Aucun de ces développements n’a à voir avec la paix. Ils signalent bien plutôt la fragmentation des blocs de pouvoir et des alliances qui dominent la politique mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, et une marche vers des conflits impérialistes où chacun se bat pour ses propres intérêts.
Comme le conclut Der Spiegel dans son article sur «L’appel de Trump au Kremlin»: «Les États-Unis ont commencé à s’éloigner de l’Europe. La conversation de Trump avec Poutine et la visite de Hegseth à Bruxelles ont dissipé tous les doutes qui subsistaient.»
L'ancien chef du service de renseignement britannique MI6 le commente ainsi: «Nous sommes passés d'un monde basé sur des règles et des structures et institutions multilatérales à un monde d'hommes forts concluant des accords au détriment de pays plus faibles et plus petits.»
Le secrétaire d'État de Trump, Marco Rubio, a résumé ainsi la politique de l’«America First»: «L'intérêt de la politique étrangère américaine est de promouvoir l'intérêt national des États-Unis d'Amérique.» Sous couvert de rejet d'un «monde unipolaire», Rubio tourne le dos aux «partenaires» traditionnels de l'Europe pour recentrer la puissance militaire américaine sur l'expansion territoriale et la concurrence avec la Chine.
Ce débat se déroulera en public à la Conférence de Munich sur la sécurité, qui se tient de vendredi à dimanche. Aux côtés de nombreux responsables politiques et militaires européens, le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'Etat Rubio y sont également présents.
Le Rapport de Munich sur la sécurité 2025, qui sert de base à la conférence, s’intitule «Multipolarisation» et décrit un monde où l’émergence de blocs de pouvoir concurrents «augmente le risque de désordre et de conflit et compromet une coopération efficace».
Concernant les États-Unis, le rapport indique: «La victoire de Donald Trump à la présidence a enterré le consensus de la politique étrangère américaine de l’après-guerre froide selon lequel une grande stratégie d’internationalisme libéral servirait au mieux les intérêts américains. Pour Trump et nombre de ses partisans, l’ordre international créé par les États-Unis est une mauvaise affaire. En conséquence, les États-Unis pourraient abdiquer leur rôle historique de garant de la sécurité de l’Europe, ce qui aurait des conséquences considérables pour l’Ukraine. La politique étrangère américaine des années à venir sera probablement marquée par la lutte bipolaire entre Washington et Pékin.»
La seule réponse de l’Europe semble être un réarmement massif pour servir ses propres intérêts impérialistes, associé à une exploitation et une répression de plus en plus dure de la classe ouvrière pour couvrir le coût de la militarisation. En cela, l’Europe avance dans la même direction que Trump.
L’article de Ralf Fücks, membre du parti des Verts, dans Der Spiegel, est un parfait exemple de l’hystérie belliciste qui règne actuellement. En tant qu’ancien directeur de la Fondation Heinrich Böll, Ralf Fücks a joué un rôle majeur dans le coup d’État de Kiev de 2014, qui a jeté les bases de la guerre actuelle.
Il accuse à présent Trump d’avoir «donné un coup de poignard dans le dos de l’Ukraine». Il reproche à la politique allemande et européenne de ne pas soutenir suffisamment l’Ukraine. « Si les Européens ne se ressaisissent pas maintenant et ne font pas tout pour défendre la souveraineté de l’Ukraine et les fondements de l’ordre de paix européen, ils finiront par sceller leur propre insignifiance politique. L’Europe ne sera plus qu’un pion des grandes puissances», affirme-t-il.
Cette approche influencera également les prochaines élections législatives allemandes. Tous les grands partis – du Parti de gauche à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) d’extrême droite en passant par les sociaux-démocrates, les Verts, les libéraux-démocrates et les chrétiens-démocrates – s’accordent à dire que l’Allemagne doit augmenter considérablement ses dépenses militaires tout en réduisant en conséquence les services sociaux. L’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), une scission anti-migrants du Parti de gauche, pour sa part, loue Trump comme un prétendu artisan de la paix.
Le Sozialistische Gleichheitspartei (SGP, Parti de l’égalité socialiste) est le seul parti qui s’oppose systématiquement à la guerre et au militarisme lors de la campagne électorale, prônant l’unité de la classe ouvrière internationale sur la base d’un programme socialiste et anticapitaliste.
(Article paru en anglais le 14 février 2025)